


Il faut relire les récits de voyage d’Ella Maillart et de Peter Fleming. Ils ont traversé ensemble la Chine en 1935 pour aller voir « ce qui se passait » dans le Xinjiang, sur quoi couraient toutes sortes de rumeurs. Un Anglais et une Helvète, bel attelage pour traverser les déserts et essayer d’approcher les seigneurs de la guerre turcophones.
Les deux livres sont disponibles en français sous les titres de Courrier de Tartarie pour Peter Fleming, et d’Oasis interdite pour Ella Maillart.

Ce que je voudrais mettre en lumière aujourd’hui, c’est le chapitre qu’ils consacrent tous deux à la situation géopolitique de la région. Prenons-en de la graine, nous qui prétendons écrire de la littérature du voyage. Qui fait encore l’effort de comprendre, de chercher, de mettre en ordre, de mettre en perspective ? Chacun à sa manière, ils rappellent l’histoire ancienne et la présence de la Chine dans cette région depuis plus de deux mille ans. Ils rappellent rapidement les invasions, les révoltes, les empires, les républiques auto-proclamées, les intérêts des grandes puissances entourant la région.
Cela me paraît à des années lumière de ce que nous lisons depuis, dans les récits de voyage et dans les reportages de journalistes. Aujourd’hui, la tendance est à la simplification pour raison humanitaire. On veut défendre les droits des Ouïghours, et on décrit une situation claire comme de l’eau de roche, comme sur le blog de Sylvie Lasserre, consacré à l’Asie centrale :
« Depuis 1949, date de l’occupation de leurs terres par la Chine communiste, les Ouïgours assistent impuissants à la colonisation han. »
L’image est simple et fausse : autrefois les turcophones vivaient libres sur « leurs terres », et soudain, en 1949, la vermine communiste est venue envahir tout cela.
Tous les récits de voyage dans la région que j’ai lus vont dans ce sens. Ce n’est pas la dénonciation de la politique de Pékin qui me choque, mais l’alliance étrange qui y est déployée entre l’absence de toute description historique et le rejet pur et simple des Chinois, comme s’ils étaient définitivement des étrangers.
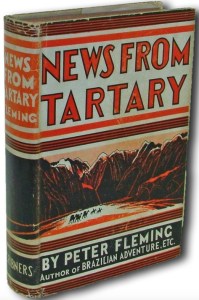
Ella Maillart et Peter Fleming, quand ils parlent de la Chine, ne voient pas d’horribles colons. Et quand ils appréhendent le Xinjiang, ils voient une terre stratégique qui attire l’attention des grandes puissances que sont la Chine, l’Angleterre, l’URSS et même le Japon. Ils voient aussi des chefs de guerre Ouïghours ou Hui, dont les armées et les révoltes sont aussi romanesques que dangereuses. On est loin des images d’Epinal.
Il faut relire Maillart et Fleming pour nous nettoyer l’esprit de l’atmosphère humanitaire et larmoyante qui envahit l’écriture du voyage et du reportage.
« Il faut relire les récits de voyage d’Ella Maillart et de Peter Fleming… » ; comme proust, personne ne les lit mais les relit…
J’aimeJ’aime
Effectivement, le ton d’Ella Maillart semble assez dur, si j’en crois la relation qu’en fait Reza dans son livre sur les routes de la Soie. Elle parle d’exécutions. Je ne sais pas si c’est mieux de se taire sur ces sujets-là…. sans doute pas, mais sans doute aussi certains lecteurs tombent dans la fascination du voyeurisme. Ma question serait plutôt le pourquoi que le comment : lit-on la littérature de voyage pour imaginer des voyages qu’on ne fera sans doute jamais, et cela suppose une bonne dose de capacité à visualiser à notre époque de médias, ou pour s’instruire de façon académique ? ou aussi, comme c’est ton cas, Guillaume, pour préparer une thèse universitaire… on lit et on regarde les images. J’étais surprise en lisant Istambul de Pamuk dont tu as parlé récemment, de voir qu’il incluait des photos dans ses pages de texte, un peu comme les graveurs d’autrefois. Donc le texte se trouve « rabaissé » au niveau d’un récit, sans qualité visuelle… Moi, j’aime le texte écrit, sans images, sec
J’aimeJ’aime
Très bonne question, Nénette. Pourquoi lit-on de la littérature de voyage ? La diversité des réponses explique le manque de reconnaissance littéraire de ce genre.
Juste une chose, cependant. Tu écris que j’en lis « pour préparer une thèse universitaire », mais c’est le contraire. Je fais une thèse sur ce sujet parce que je voulais comprendre pourquoi j’aimais tant certains textes qui se trouvaient être des récits de voyage, et qui me semblaient posséder une poétique bien à eux, irréductible à la fiction.
J’aimeJ’aime
Une autre bonne question posée par Nénette, c’est celle du rapport photos/textes dans un récit de voyage. Pamuk alterne photos et textes. Il y
J’aimeJ’aime
Une autre bonne question posée par Nénette, c’est celle du rapport photos/textes dans un récit de voyage. Pamuk alterne photos et textes. Il y
J’aimeJ’aime
Il y a aussi les récits sans photos (ex : Rolin), et les photos sans « récit » (ex: Bouvier sur le Japon).
Personnellement, je me souviens qu’on avait déja parlé de ça à l’époque de Chines ou même Nankin en douce. A l’époque, j’appréciais davantage (comme lecteur) le texte sans photos. Les photos me paraissaient appauvrir le portrait de l’endroit. Une photo n’est pas souvent réussie, et même quand elle l’est elle réduit un peu la perception à des données purement visuelles. Or, par son impact, l’image écrase le reste et crèe une sorte de paresse du lecteur qui va survoler le texte.
Maintenant, j’ai changé d’avis. comme « auteur », si je peux employer ce mot, plus ça va, plus j’ai envie de mettre des photos quand je veux essayer de décrire un endroit, comme Douala par exemple. Mon texte m’interesse moins que ce que je vois et je retrouve ce que j’ai vu dans l’image que j’en montre. Les impressions subjectives et les interprètations du voyageur deviennent mesquines par rapport à l’attirance qu’il ressent pour l’extérieur.
Mais c’est peut-être une réaction regrettable du point de vue littéraire. A la limite, ça conduit au silence. Alors on peut peut-être considèrer le silence comme la forme ultime de la création littéraire, Bouvier aurait sûrement été d’accord avec ça, mais ça pose un problème du point de vue de la production du « récit de voyage ».
Et alors, la question, c’est pourquoi écrit-on des récits de voyage ? Est-ce que c’est la même pulsion qu’on trouve chez les touristes qui veulent absolument montrer à tout le monde leurs photos de voyage ?
J’aimeJ’aime
Peut-être que le bon texte de voyage vient des insuffisances de l’image, et les bonnes images de l’insuffisance de l’écrit. SI je devais écrire un récit de voyage, c’est comme ça que j’envisagerais les choses.
J’aimeJ’aime
Oui, il faudrait en effet ne pas avoir à dire par les mots ce que les images montrent déjà. Quand un auteur le fait quand même, comme Rolin parfois, son texte devient à la fois très poétique et presque halluciné à force d’être précis et détaillé.
En général, il convient de ne pas faire se chevaucher l’image et le texte mais de les faire jouer en contrepoint, et si on n’a rien de plus à dire que ce qui est déjà sur l’image, autant ne rien dire.
Le récit de voyage contemporain est souvent l’opposé des soirées diapos, car il s’agit souvent d’apporter de faire voir par le texte des territoires et des vies que l’on a maintenant déjà vus (en image) cent fois.
J’aimeJ’aime
On peut même penser que sur la plupart de destinations nous avons déjà des tonnes d’images dans la tête, et qu’il convient désormais de décrire en se contentant d’invoquer ces images par des petits détails qui viennent les compléter.
J’aimeJ’aime
La litterature de voyage contemporaine et de demain c’est dans les blogs qu’elle se manifeste le mieux ; en plus de la photo il y a la video , c’est trés important comme point. Meme capital. Bouvier, c’est encore le dix neuvieme siécle, il sert de jonction entre les deux médias (ecrits/images)…le vrai progrés, la vraie avancée c’est le reportage documentaire télévisé, le scénario de ces documentaires.
J’aimeJ’aime
On ne peut pas dire ça. Personnellement, je ne lis pas beaucoup de récits de voyage, mais il est évident qu’un reportage formaté pour les besoins de la té n’aura jamais le niveau d’un vrai récit de voyage. Il y a une sorte de superficialité écoeurante dans ces tonnes d’images dont parlait Mart qui constituent notre culture du voyage. Regarder les images d’un type qui montre le pittoresque standardisé d’un endroit plus ou moins exotique n’est satisfaisant que pour le troisième âge qui s’emmerde dans sa maison de retraite.
La seule manière satisfaisante de montrer un voyage serait plutôt de montrer les transformations qu’il fait sur le voyageur, mais c’est moins facile que de pointer son objectif sur des habitants convenus d’un tiers-monde édulcoré. Cependant, l’image de ce que tu vois, ce que tu vois sur l’image, c’est aussi ce tu as dans la tête, et dès lors pour comprendre quelqu’un, il est plus efficace de regarder dans la même direction que lui, que de discuter avec lui pour voir ce qu’il a dans la tête. Et les images passent moins bien par la parole que par le nerf optique. Les transformations que ce que tu vois crée dans ta tête, tu peux peut-être les déclencher à nouveau ou en provoquer de nouvelles en montrant autour de toi l »‘image du monde ».
J’aimeJ’aime
J’en profite, tant qu’internet a l’air de vouloir marcher, pour ajouter que ce qui me restera peut-être de l’Afrique quand j’en serai parti, ce seront juste quelques images qui ont pour moi une sorte de pouvoir obsèdant, comme celle-ci : une rue poussièreuse de la Cité, à Pointe Noire, Congo, sans trottoir, sans lumière, le soir, quand il n’y a pas d’électricité et qu’on s’éclaire à la lampe à pétrole, pleine de taxis, de promeneurs et de filles qui passent en chantant. Ou d’autres, qui lui ressemblent, d’autres villes africaines. Celui qui réussira à mettre une telle image dans la tête de quelqu’un d’autre, il aura réussi à « réciter » son voyage.
J’aimeJ’aime
« une rue poussièreuse de la Cité, à Pointe Noire, Congo, sans trottoir, sans lumière, le soir, quand il n’y a pas d’électricité et qu’on s’éclaire à la lampe à pétrole, pleine de taxis, de promeneurs et de filles qui passent en chantant. »
C’ets un bon exemple de ma théorie. Le début est conforme au cliché universellement partagé : « une rue poussièreuse de la Cité, à Pointe Noire, Congo, sans trottoir, sans lumière, le soir, quand il n’y a pas d’électricité et qu’on s’éclaire à la lampe à pétrole ». On a vu ça dans le dernier film avec Tom Cruise. Ca s’anime avec « pleine de taxis », car on voyait plutôt jusque là une rue déserte. Ca retombe avec « de promeneurs », car on devinait dès le début qu’il pouvait y avoir des promeneurs, c’était une des versions du cliché avec Tom. Et ça remonte franchement avec « et de filles qui passent en chantant » car là non plus on ne s’attendait pas à les trouver : des putes pourquoi pas, des filles qui chantent pourquoi pas, mais des pas putes qui passent en chantant, ça surprend et retient l’attention : où vont-elles et pourquoi chantent-elles?
En s’appuyant sur le corpus des clichés, on peut faire des descriptions très vivantes.
J’irai plus loin : sans cliché, on ne peut pas faire de description vivante, car il faut une base de départ pour l’imagination.
J’aimeJ’aime
Ah oui, le problème de l’image, c’est le cliché. C’est étonnant comme des clichés peuvent s’interposer entre l’image dont on se souvient (tu étais assis devant Chez Gaspard, en train de manger des trucs superbons, et tu regardais la rue, tu n’as pas vu le dernier fim avecTom Cruise) et celle qu’on essaie de montrer. Peut-être que tu n’as vu Pointe Noire ou Douala qu’à travers les clichés que tu avais déja dans la tête, en chercdhant dans ces villes ce qui allait venir les confirmer. Mais je n’en suis pas si sûr. Le voyageur suprême a la tête vide, il voit sans regarder, il est comme une chambre d’enregistrement, disait Christopher Isherwood, qui s’y connaissait en voyage comme savent le faire les Anglais.
J’aimeJ’aime
Chouette débat trés inspirant.
J’aimeJ’aime
Le meilleur récit de voyage avec image, et quasiment sans cliché non plus, ni dans les images, ni dans le texte, c’est à mon avis « L’Empire des signes » de Roland Barthes.
Je vous invite tous à en acquérir une belle édition (la mienne est en poche point seuil et est déjà très belle) car c’est un livre qui se garde, qui se savoure et se reprend sans cesse. Un pur chef d’oeuvre d’écriture, de pensée, d’observation, mais aussi de tendresse, de drôlerie, de sensualité, de mollesse et d’assurance. Quand on s’y met, on n’en revient pas.
J’aimeJ’aime
Le voyageur idéal dans l’empire chinois (qu’il ne faut pas confondre avec la Chine) devrait emporter Sima Qian, le roman des Trois Royaumes, la Pérégrination vers l’Ouest, (plus quelques volumes de chroniques et d’autres que je ne connais pas) tout ce que le lettré chinois a dans la tête. Sinon on produit ce que nous produisons: l’équivalent de ce qu’écrirait sur la France un Chinois qui n’aurait jamais entendu parler de César, saint Martin, Clovis, Attila, Charlemagne, les Croisades, et pour qui l’histoire de l’Europe commencerait le jour où les Portugais ont abordé à Macao (au mieux). Maintenant que mon ignorance de la Chine s’est un peu élargie, je suis horrifié des inepties que j’ai pu dire ou écrire il y a seulement quelques années.
Quelque chose de complètement différent: un bienfaisant pseudonyme a mis en ligne le livre de Jacques de La Tocnaye, voyageur réac et cultivé du temps de la Révolution, « Voyage d’un Français dans l’Irlande ». http://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Jacques_de_Latocnaye , dont il fut question ici il y a quelques mois.
J’aimeJ’aime
Génial, merci Ebolavir. Vous le trouvez réac, de Latocnaye ? Pourquoi ?
Pour ce qui est de la Chine, de toute façon, on sera toujours l’ignorant de son voisin. Celui qui parle trop mal chinois sera disqualifié pour toujours et quelles que soient ses paroles. Celui qui maîtrise la langue ma
J’aimeJ’aime
Celui qui maîtrise la langue mais qui a peu de lecture sera disqualifié tout autant. Le Chinois sera suspect de nationalisme ou de manipulation; l’étranger de sentiment anti-chinois. Celui qui cite Sima Qian sera moqué car on lui dira que la Chine a évolué.
L’idéal est de savoir circonscrire sa parole à un domaine clairement défini, ce que je n’ai jamais fait moi-même, mais que vous, Ebolavir, avez réussi à faire la plupart du temps.
J’aimeJ’aime
»“L’Empire des signes” de Roland Barthes….mais il a ecrit un livre sur la photo aussi non ?
J’aimeJ’aime
Dans le registre « name-dropping », tu connais Isherwood, Guillaume ? C’est un Anglais qui a passé les années trente à Berlin et qui raconte ça dans plusieurs livres, comme « Mr Norris change de train », puis qui raconte comment il a raconté ça dans un autre livre : « Christopher et son monde ». Une sorte de récit du récit de voyage, en quelque sorte. Bien sûr, c’est pas intello comme Barthes, mais bon, tout le monde ne peut pas se permettre d’être aussi chiant que Barthes. Il y a aussi des gens qui travaillent pour gagner leur vie.
J’aimeJ’aime
Ce qui est chiant , c’est surtout les éléves qui continuent de bavasser quand on essaye de se concentrer sur une liste de commande !!!
J’aimeJ’aime
« tout le monde ne peut pas se permettre d’être aussi chiant que Barthes »: Ben, ceci est tellement gratuit et loin de tout. Je te le recommande chaudement, ce livre étonnant et en aucun cas chiant. L’Empire des signes (je n’aime pas le titre, mais je suppose qu’il a été donné d’après le titre français du film japonais L’Empire des sens) est court, nerveux, intellectuel certes, mais ce qui est chiant l’est souvent par manque d’intellectualité et de culture.
Pour moi, c’est un livre (je précise que c’est un « livre », et non seulement un texte, car ce sont aussi les images qui entrent dans la lecture) que je déguste, parfois. Une page de bon matin, pour me mettre en forme, en bonne humeur.
Le lecteur y navigue sur des ondes sublimes, si je puis me permettre. Ce qu’il décrit, les renversements de perspective qu’on y trouve, ce n’est pas seulement beau, mais ça a ce côté effrayant, dégoûtant, inconfortable du sublime. Et cela reste chuchoté, maîtrisé, plat.
J’aimeJ’aime
Pour ce qui est d’Isherwood, je ne l’ai jamais lu. C’est vrai que les écrivains de l’entre-deux-guerres pratiquaient tous le travel writing, même en France. C’est après la guerre que ce genre d’écriture a été perçu comme un sous-genre.
Ce que tu appelles « Christopher et son monde » est la traduction de « Christopher and his Kind », un jeu de mot entre Christopher et son genre, et Christopher et son gentil, son mignon. Comme c’est une autobiographie, il raconte comment il a écrit ses livres, c’est donc autant un méta-récit de voyage que toutes les autobiographies d’écrivains voyageurs.
Bref, non, je ne le connais pas bien, mais je sera
J’aimeJ’aime
is ravi que tu m’en parles plus amplement la prochaine fois qu’on se voit.
A propos des écrivains du voyage pendant l’entre-deux-guerres (surtout chez les Anglo-Saxons), voir le désormais classique « ABROAD, British literary traveling between the wars » de Paul Fussel (Oxford University Press, 1980).
J’aimeJ’aime