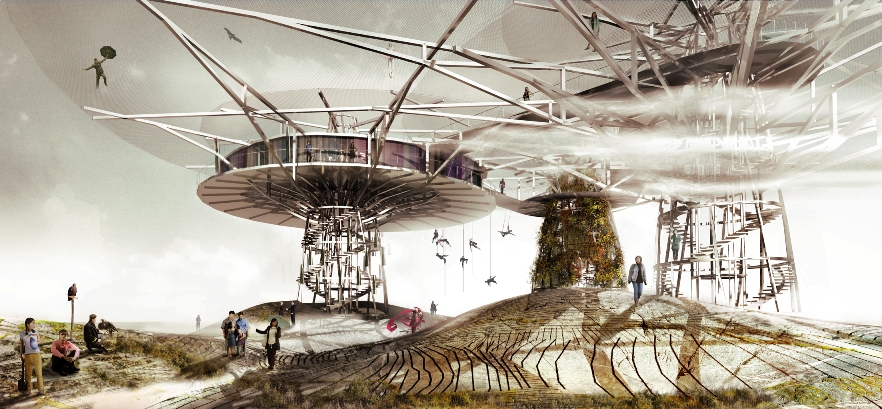J’aimais bien Philippe Val à l’époque où il faisait un duo avec Patrick Font. Font et Val se produisaient dans des salles de province et provoquaient un rire immense. J’étais trop petit pour tout comprendre, mais les Salles des fêtes et les Bourses du travail pouvaient être secouées de fous rires que je n’ai jamais revus ailleurs. Ils chantaient, usaient d’un langage scabreux, scatologique et intellectuel, et faisaient des sketches à connotation politique et religieuse. Val avait une belle voix et, dans le duo, prenait un peu le rôle du bellâtre raisonnable, alors que Font prenait celui du vieil obsédé. Val était dans le self control, Font dans le retour du refoulé. C’est ce retour qui provoquait le rire incontrôlable.
Val est devenu célèbre en prenant la tête de Charlie Hebdo, dans les années 1990. Je n’ai jamais trop lu cet hebdomadaire, je le feuilletais chez des amis. La seule fois que je l’ai acheté, c’était la semaine suivant le 11 septembre 2001. Je fus déçu, rien n’y était dit, aucune prise de position originale. Les éditos de Val m’horripilèrent, tout comme ses chroniques sur France inter, qui ne me faisaient jamais rire et ne me faisaient pas réfléchir non plus. J’étais surtout frappé par sa passion pour l’interdiction, l’exclusion et l’anathème. Parce que telle chose était repérée comme nocive (un parti politique, une publicité, une pratique commerciale ou culturelle), il fallait l’anéantir.
L’affaire Siné n’est donc pas un accident, selon moi, mais un épisode nécessaire de la logique de Val. Non seulement Val veut ôter les affreuses paroles antisémites qui dégradent l’image de son journal (Siné a commis le crime d’écrire : « Il ira loin ce garçon », c’est vrai qu’il a dépassé les bornes), mais il exige de Siné des excuses publiques. Cette exigence a quelque chose d’humiliant qui entre parfaitement dans le « système Val », pour qui la politique consiste à interdire, à exclure, à contrôler, à vérifier.
Je me souviens d’un dessinateur phare de Charlie Hebdo qui se plaignait de n’avoir pas été autorisé à publier des caricatures de Bernard-Henri Lévy, car Val ne voulait pas qu’on se moque d’un intellectuel pour ne pas se tromper d’ennemi (l’ennemi étant l’antisémite, le raciste ou le fanatique). Le dessinateur (dont je ne dévoilerai pas le nom, pour ne pas lui faire courir le risque d’être viré lui aussi) m’a montré ses dessins. Je les ai trouvés vraiment intéressants et marrants. Ils moquaient l’imposture d’un penseur à la mode. Le patron, Philippe Val, a protégé l’imposture intellectuelle, et aujourd’hui, le même BHL soutient activement Val dans l’affaire Siné. Il y a là-dedans quelque chose de gênant, d’un peu nauséabond, qui entache, je pense, l’image d’un journal (et de son rédacteur en chef) faussement libre et incroyablement conformiste.
Je l’ai entendu sur France Culture donner une conférence sur « Le rire de résistance », dans laquelle il expliquait que la gouaille était collaboratrice, mettant dans le même panier Mistinguet, Maurice Chevalier et Louis Ferdinand Céline (faisant croire au passage que Céline parlait avec gouaille, ce qui est tout à fait faux). Il ouvrit sa conférence avec une anecdote qui se passait en Chine, et parlait d’ « annexion » de Hong Kong par la Chine Populaire, ce qui est, aussi, une erreur grossière. Le pire, dans cette conférence, est qu’il se considèrait lui-même, sans autodérision ni recul, comme un parangon du « rire de résistance ».
Aujourd’hui, il faut peut-être résister à Philippe Val. Résister à la tentation de ce totalitarisme bien pensant. Résister aux dérives du politiquement correct, car la liberté d’expression est menacée à l’intérieur même de la presse satirique.
Avec le temps, je me suis aperçu que je préférais Patrick Font. Il était beaucoup plus talentueux, plus hilarant, mais aussi plus fou, plus pervers que Philippe Val. Ses chansons étaient mieux écrites, plus poétiques quand il voulait être poète, plus drôles quand il voulait être drôle. Tandis que Val donnait des leçons de politique, Font pétait les plombs et pouvait entrer sur scène tout nu, sans raison apparente, ou se lancer dans une improvisation délirante. Il n’est peut-être pas insignifiant qu’aujourd’hui, Patrick Font soit condamné à l’obscurité et l’ignominie, après avoir fait de la prison, et que Philippe Val jouisse de tous les avantages de la vie médiatique : riche, célèbre, soutenu par un aréopage de personnalités influentes, donc protégé, il est dans la lumière, dans son bon droit, la conscience infiniment tranquille.