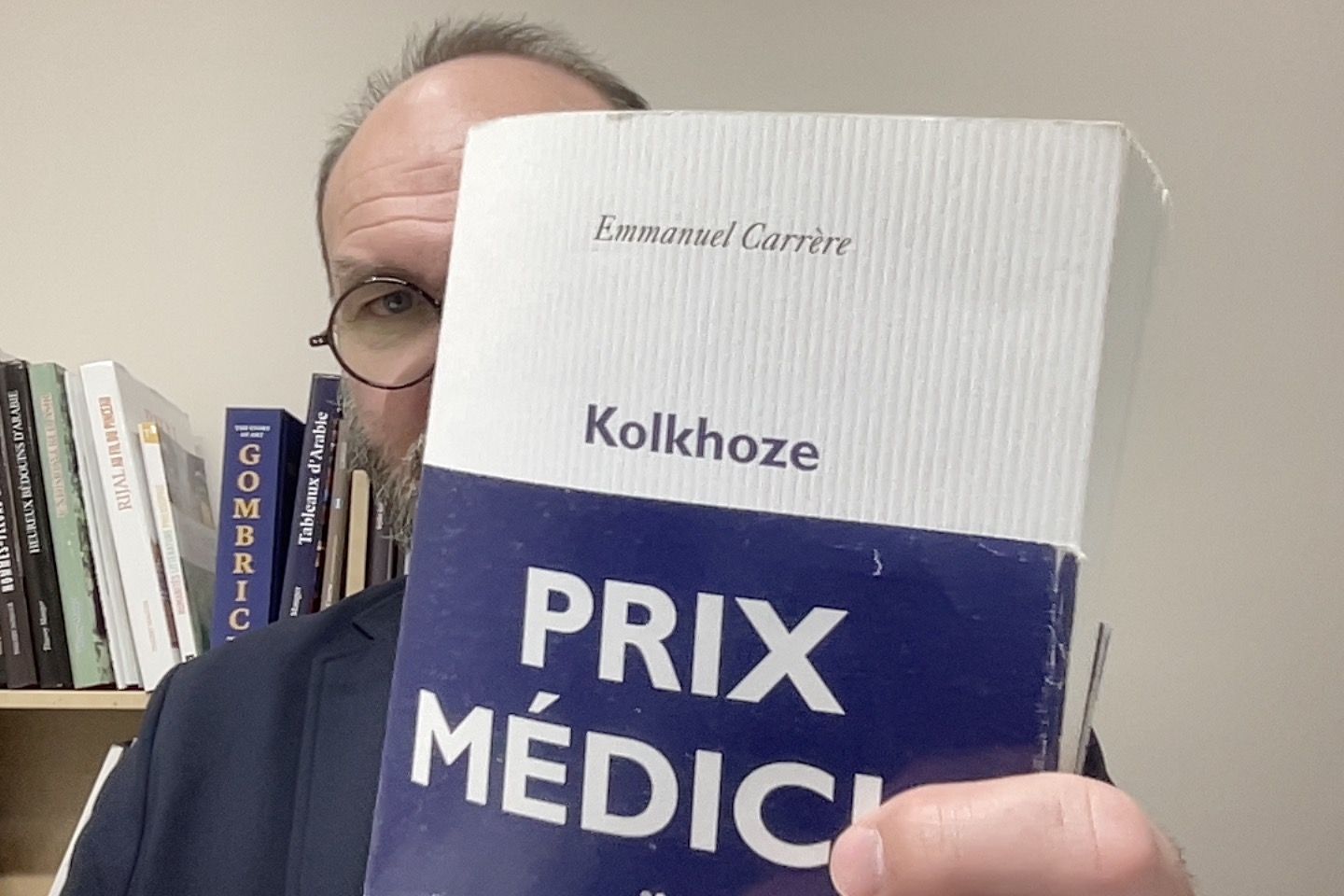Le dernier livre d’Emmanuel Carrère, Kolkhoze (P.O.L, 2025), est comme toujours un régal à lire mais encore une fois un peu décevant. Je le dis avec tristesse et même un peu d’inquiétude après avoir éprouvé une légère colère à la lecture, car je voue une admiration sans borne à Emmanuel Carrère, et le voir sombrer comme cela me fait de la peine.
Il raconte la vie de sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, spécialiste de la Russie et patronne charismatique de l’Académie française. Chemin faisant il dresse le portrait de son père, dont la personnalité attachante tend à s’effacer volontairement devant la puissance de sa femme. Ce portrait croisé entre une femme brillante et un homme feutré est réussi, et comme tous les deux sont morts, Emmanuel est libre d’écrire ce qu’il veut. Or le livre n’est pas aussi tenu que je le laisse entendre.
Il passe d’une histoire à une autre avec liberté mais il ne parvient jamais à retrouver cette impression d’unité et de cohérence mystérieuse qui faisait la marque de ses livres précédents. Tout le long de Kolkhoze, Carrère espère que le lecteur trouvera le coeur battant de son récit qui, dans les faits, se perd dans une multitude de chapitres qui peinent à faire écho les uns dans les autres. Oui, scolairement, on peut le lire en montrant tous les liens qui sont censés amalgamer l’ensemble, mais cela reste un exercice scolaire car on sent un auteur dépassé par son propre projet et incapable de mettre les coups de reins nécessaires pour faire la différence quant à l’intégration des éléments disparates dans un dispositif harmonieux.
Vers la fin du récit, quand le narrateur voyage en Ukraine pendant la guerre d’invasion de l’armée russe, il dévoile l’ambition littéraire qui était la sienne :
Je crois alors, j’espère que ce sera cela, ce livre (…) : les histoires enchevêtrées de ma famille russe et de la défaite de la Russie – un événement géopolitique aussi énorme que l’effondrement du communisme.
Kolkhoze, p. 468.
Eh bien non, ce n’est pas cela ce livre. Les histoires sont effectivement enchevêtrées, mais en aucun cas le lecteur ne ressent la présence d’un « événement énorme ». Et pourtant il savait faire cela, il savait nous mettre en présence d’un tsunami mental et relationnel qui allait tout emporter ; or le millésime 2025 de Carrère est un ouvrage riche, passionnant et raté.
Je parle ici d’un écrivain qui publie peu de livres mais qui a fait des chefs d’œuvres pendant vingt ans. De La Classe de neige (1995) jusqu’à Royaume (2015), Emmanuel Carrère a su à chaque fois écrire une œuvre parfaite et nouvelle, dont le lecteur se disait à la fin : « C’est génial, celui qui a fait ça peut se reposer, il ne pourra rien faire de mieux, ceci est l’œuvre d’une vie » : pour reprendre une référence de La Peste d’Albert Camus, les lecteurs avaient la réaction dont rêve le personnage qui essaie d’écrire un livre sans jamais le terminer : « Messieurs, chapeaux bas ».
Et à chaque fois, Carrère réussissait à se surpasser, se réinventer, et à explorer de nouveaux territoires littéraires qui étaient à la fois inouïs et reconnaissables. Inouïs parce qu’on n’avait jamais lu de choses pareilles, mais reconnaissables parce qu’on gardait ce lien familier avec la voix narrative de Carrère. Mais il semble que les années 2020 marque une rupture dans la carrière de l’écrivain.
Déjà, avec Yoga (2020), j’avais été déçu mais la déception était inscrite dans la confection du livre lui-même : il racontait un épisode de dépression épouvantable et, alors que sa femme avait joué un rôle central dans sa vie, elle lui avait interdit, dans les affres de leur rupture, d’écrire quoi que ce soit sur elle dans le livre qu’il préparait. Comment voulez-vous réussir un livre lorsqu’un personnage principal de l’histoire est manquant ? Carrère a opté pour une solution bancale, il a inventé des personnages et des anecdotes qui n’étaient pas à la hauteur de la réalité. On sentait, sans rien savoir des démêlés judiciaires qui opposait l’auteur et sa femme, qu’il y avait de la fiction dans Yoga, mais une fiction de mauvais alois. On n’y croyait pas, ça sonnait faux.
Mais comme je l’ai dit plus haut, cette contrainte faisait presque partie du projet littéraire puisque son conflit avec sa femme était une des répercussions de l’état dépressif du narrateur qui était au centre du récit. Yoga était donc insatisfaisant mais on le comprenait en tant que lecteur car on était dans un pacte autobiographique et qu’il était évident qu’une grande partie de la réalité nous était interdite. Carrère avait toujours inclus dans ses grands récits les effets dévastateurs de son écriture chez ses proches et donc sur lui-même. Dans Un Roman russe, par exemple, on savait qu’il brisait un tabou familial et que, au mépris de l’interdiction faite par sa mère, il avait décidé de raconter l’histoire de son grand-père qui avait collaboré avec les nazis pendant l’Occupation. Avec Yoga, le pacte de lecture n’était pas respecté car Carrère a cru qu’il pourrait s’en sortir avec des fictions mais les lecteurs avisés repérait aisément les défauts de construction, comme une maison qui serait rénovée par des artisans différents. Ceci dit, Yoga restait un grand livre et il y avait des pages fascinantes sur la maladie, sur la méditation, sur le yoga, et surtout Carrère avait su tenir les deux bouts de l’histoire apparemment sans rapports : la pratique du yoga et l’internement en hôpital psychiatrique.
Avec Kolkhoze, je prends la plume pour dire que la déception est plus nette car le problème vient de l’écriture elle-même et non de problèmes contingents. Le livre n’est pas du tout maîtrisé, Carrère semble n’être que l’ombre de lui-même, en perte de repères et on le surprend bien des fois à faire du remplissage. Notamment quand on arrive au chapitre « Un enfant sage » où il débite des banalités sur les écrivains pro et anti-communistes des années 1950 et 1960. J’y reviendrai. Il y a beaucoup de négligences dans les réflexions qu’il fait tout le long du récit :
L’avantage d’être venu pour un reportage, c’est qu’on fait des choses qu’on n’aurait pas faites autrement.
Emmanuel Carrère, Kolkhoze, p. 449
En effet, et on pourrait dire cela de tout et n’importe quoi : l’avantage d’être ici pour une réunion de famille, c’est qu’on voit des gens qu’on n’auraient pas vus autrement. L’avantage de faire ce métier, c’est qu’on reçoit un salaire qu’on n’aurait pas reçu autrement. On peut continuer longtemps à enfiler de telles perles.
Ou encore le chapitre « Les premiers jours de la guerre » dans les pages 415-430, où il se sent obligé de raconter par le menu les jours passés à Moscou lorsque Poutine a envahi l’Ukraine en 2022. Il ne sait pas pourquoi c’est intéressant, mais dans le doute il se dit : « Quand même, c’est un moment historique, autant que je raconte tout ce dont je me souviens, ça a des chances de taper juste… » Même chose avec les pages consacrées à sa cousine qui se trouve être élue présidente de la république géorgienne. Carrère n’est pas inspiré mais il va au charbon parce qu’après tout c’est son métier : « Au diable l’inspiration, se dit-il : je leur parle d’un membre de ma famille donc je suis dans le thème du livre ; ma cousine dirige la Géorgie ce qui correspond aussi au thème du livre, et comme en plus elle est présidente de la république, je touche forcément à l’Histoire. Je ne peux donc pas me tromper complètement… »
Le moment Sartre : le point de rupture
Quand il critique Jean-Paul Sartre d’une manière qui est au niveau de n’importe quel journaliste de plateau télé, je fulmine. Carrère a beau être de droite, il ne tombe pas d’habitude dans la caricature bourgeoise sans conscience de classe. Ce qu’il dit de Raymond Aron et la formule « mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron » est un concentré de poncifs médiatique ; et quand il cite l’éternel « un anticommuniste est un chien » de Sartre, Carrère verse dans le cliché éculé, et il ne fait pas le moindre effort pour éclairer ces idées creuses de manière nouvelle. Le vrai Carrère aurait considéré ces formules dans leur statut de clichés idéologiques et il en aurait fait quelque chose d’intéressant, alors qu’ici il semblait à bout de souffle et s’est borné à nous dire que les intellectuels pro-communistes étaient dans l’erreur.
Là, me suis-je dit, à la page 285, vraiment, il va trop loin. Trop loin dans le manque de travail. Trop loin dans la négligence. Il a écrit un livre de plus de 500 pages. Rien ne l’empêchait de le travailler davantage. Il pouvait sans peine resserrer son récit et ses analyses pour en faire une perle dense de 300 pages.
Dans ce passage qui m’a agacé, il parle de la vie de sa mère en 1968. Il explique qu’elle reste anticommuniste parce qu’elle est une femme de droite et que son histoire familiale rend le soviétisme traumatisant pour elle. Très bien, pourquoi pas. Mais j’attends de Carrère une analyse plus profonde et surtout plus inattendue des concepts de « droite » et de « gauche », alors qu’il ne dépasse jamais le stade des poncifs. Et lorsqu’il en vient aux clichés anticommunistes rebattus, cela ne ressemble plus du tout à Carrère.
Ce n’est pas qu’il ait tort. C’est juste banal. Et ce qui est grave, c’est que ce n’est pas ce que fait Emmanuel Carrère d’habitude.
Ce que Carrère savait faire
Depuis La Classe de neige jusqu’à Yoga, ses livres étaient pleins de vie. Ce n’était pas négligé. Il n’y avait pas ces pages inutiles. Kolkhoze est bourré de pages inutiles. J’ai commencé à en sauter. À lire en diagonale, ce que je fais rarement. Je ne pratique la lecture rapide que lorsque je dois avaler des kilomètres de textes pour des raisons professionnelles. Quand je lis un roman, au contraire, je suis attentif à toutes les phrases et je confesse être un lecteur lent. Je lisais donc en diagonal, mais presque avec culpabilité, parce qu’avec Carrère, on ne sait jamais : ces éléments apparemment secondaires pouvaient toujours se resserrer plus tard, devenir essentiels.
Avec cette séquence sur Sartre, il brise quelque chose d’autre. Depuis les années 1990, Carrère nous avait habitués à une remise en question permanente. À cette capacité de reprendre ce que l’on croyait comprendre, des personnages, des mouvements de pensée, et de les éclairer autrement. Il trouvait toujours un angle inattendu, une lumière crue, stimulante. Dans Kolkhoze, rien de cela. Il reprend des clichés au premier degré, et c’est exactement ce qu’il ne faisait pas dans ses livres des années 2000.
Sonner l’alarme
Alors oui, je tire la sonnette d’alarme. On est peut-être en train de perdre Emmanuel Carrère. C’était pour moi le meilleur écrivain de France, avec Jean Rolin. Aujourd’hui, on sent un auteur en perdition. J’espère qu’il n’est pas retombé dans une dépression qui l’empêche de travailler. Mais puisqu’il prend des années pour écrire un livre, il faut s’inquiéter.
Voyez ce qu’il écrit sur les traitements chimiques et électriques de sa maladie mentale, surtout dans Yoga, mais aussi dans Kolkhoze. Il perd la mémoire, il perd des facultés mentales et intellectuelles, qui ne sont peut-être pas nécessaires pour mener une vie « normale » dans la société mais qui l’étaient, visiblement, pour réaliser les grandes constructions subtiles qu’étaient ses romans inclassables.
De l’amour et de l’intelligence : Des Fleurs pour Algernon
La Précarité du sage, 2025
Peut-être assistons-nous, depuis dix ans, à la fin d’un auteur. Peut-être n’a-t-il plus l’énergie ni la souplesse mentale de faire ce métier.