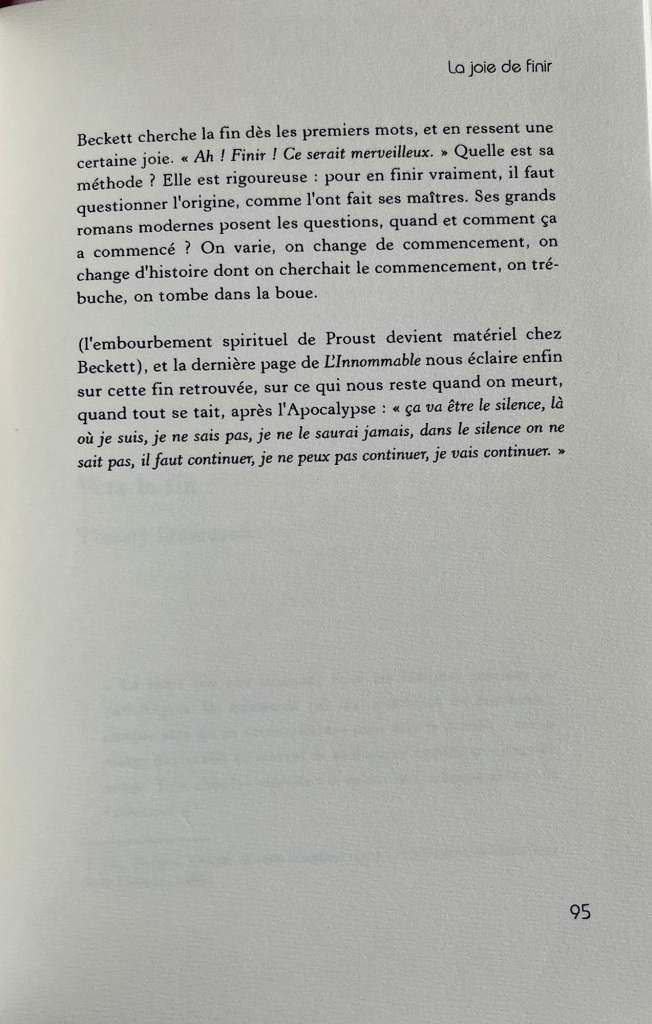À partir du verset 35, qui recommande de régler les conflits conjugaux par une réunion paritaire de conciliation, le coran quitte momentanément la question des femmes et des enfants pour se diriger vers d’autres types de désaccords. Une longue parenthèse s’ouvre pour parler de divorces, à l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté des musulmans.
Le divorce
Une centaine de versets plus tard, le couple et la femme referont surface et le Coran répétera que l’équité est impossible quand on a plusieurs épouses, et que la réconciliation est préférable en cas de querelles. En revanche, le divorce est parfaitement admis et la femme a la garantie de pouvoir refaire sa vie :
Si les deux se séparent, Allah de par Sa largesse, accordera à chacun d’eux un autre destin.
Coran, IV, 130
Le divorce n’est pas seulement toléré de manière formelle. Le système matrimonial mis en place par l’islam permet aux femmes, à travers la dot, une part non négligeable des héritages et l’obligation pour l’homme seul de subvenir aux besoins de tous, d’acquérir un pécule. Ce pécule favorise l’autonomie financière nécessaire à la femme en cas de séparation ultérieure.
Ceci est une réponse à ceux qui rappellent la parole de Jésus selon laquelle « ce qui a été fait par Dieu ne peut être défait par les hommes ». Pour l’islam, un mariage n’est pas un sacrement, n’est pas « fait » par Dieu. C’est une union scellée entre êtres humains qui ouvre le droit à la sexualité, et qui peut être révoquée. En revanche, ce qui est toléré par le coran n’est en aucun encouragé : comme la polygamie, la possession d’esclaves et l’usage de la violence, le divorce est toléré mais dans des limites strictes, après avoir faits des efforts manifestes pour donner sa chance à la réconciliation.
Les mésententes entre les hommes de la communauté
La séparation entre les hommes est aussi ce qui taraude la sourate IV. Une grande partie y est consacrée à des dissidents, des frondeurs, des déserteurs, des mutins et des hypocrites, voire des traitres. C’est pourquoi il faut s’apprêter à lire des dizaines de versets sur des individus qui ne sont pas en harmonie avec le Prophète et la parole de Dieu, bien qu’ils fassent partie, plus ou moins, de la communauté des musulmans.
La sourate IV expose alors une taxinomie des différents niveaux de divergence entre le croyant parfait et l’infidèle le plus hostile. Le croyant parfait n’est qu’un concept, les hommes sont imparfaits et le coran vient parler la langue des imparfaits pour les ramener vers le bon chemin. Mais il y a beaucoup à faire pour rappeler aux croyants qu’il faut être bon, tempéré, modeste et généreux. Les avares, les arrogants, les extrêmistes doivent essayer de se réformer. Et puis vous, les faibles mortels qui ne pouvez résister à la tentation, tâchez de vous modérer quand vous buvez de l’alcool :
Ô les croyants ! N’approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites
Coran, IV, 43
Aux premiers temps de l’islam, l’alcool était donc autorisé, et puis il a fallu l’interdire pour des raisons évidentes, malgré le plaisir qu’il apporte, et les « bienfaits » qu’il peut apporter. Malheureusement, comme on s’en rend aujourd’hui compte avec d’autres produits comme le sucre et le sel, l’alcool a tôt fini par tout détraquer dans la santé des hommes.
Plus important, la sourate IV s’emploie à désigner ceux qui divorcent d’avec le Prophète.
Et quiconque fait scission d’avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s’est détourné, et le brûlerons dans l’Enfer.
Coran, IV, 115
L’enfer sera la punition de ceux qui se détournent de Dieu, c’est la base des religions monothéistes, mais il y a toujours de la place pour le pardon et le retour vers le bon chemin, donc le Prophète doit toujours manier la carotte et le bâton. N’allez pas trop loin dans la mésalliance car vous pourrez bénéficier de notre grandeur d’âme, vous pouvez toujours trouver une rédemption, mais n’attendez pas trop quand même non plus car les flammes de l’enfer vous attendent, etc.
En particulier un mot revient souvent : « mécréants », transformé dans toutes les déclinaisons que permet la langue arabe : kufar, kafirun, Lilkāfirīna, kafaru, en fonction de sa place dans la grammaire de la phrase, si c’est un nom ou un verbe, etc.
Le mot koufar vient de la clé KFR, qui à l’origine désigne les paysans qui recouvrent de terre grains et graines. Le geste fondamental est celui de couvrir, recouvrir, dissimuler, voiler la vérité. Donc ce qu’on traduit par « mécréant » ne désigne pas celui qui n’est pas musulman parce qu’il est élevé dans une autre culture, mais celui qui a vu et compris la « vérité » et qui retourne aux illusions passées. Typiquement, il a bien compris que les pierres dressées n’avaient aucun pouvoir, que les idolâtrer n’était que de la superstition, mais après quelques temps il décide d’aller quand même sacrifier une bête dans un temple pour telle pierre sacrée parce qu’on ne sait jamais.
Ces gens causent beaucoup de soucis au Prophète, car ils ont cru en Dieu puis se sont désolidarisés des croyants, et on comprend à travers les versets que certains sont devenus de véritables ennemis mortels de la communauté, tandis que d’autres pourraient facilement réintégrer le groupe des croyants. Selon les versets, on sent que Dieu joue avec la conscience du Prophète : avec certains il faut être généreux, pour d’autres il faut montrer de la sévérité, d’autres encore ne méritent que du mépris, voire des châtiments mortels.
Il est clair qu’à ce moment de l’islam, la descente du Livre sacré, la constitution de la communauté religieuse est encore mouvante et fluctuante. Les « mécréants » sont donc des gens dont la foi n’est pas assurée et font des allers et retours vers l’islam, on ne peut pas compter sur eux. D’un côté, il ne faut peut-être pas leur fermer la porte, car Dieu est généreux et miséricordieux. D’un autre, il faut savoir dire stop :
Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n’ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin.
Coran, IV, 137
On le voit, les choses ne sont pas noires et blanches. Contrairement à ce que pensent des islamistes extrêmistes et des islamophobes, il ne suffit pas d’être musulman pour être sauvé ni pour profiter de la solidarité. Car il y a encore un autre degré d’infidélité, entre le croyant et le « mécréant », c’est celui des « hypocrites » (Al Munafiqina) qui n’ont que l’apparence du croyant mais qui n’y croient pas vraiment. Ils sont paresseux, velléitaires, et ostentatoires. Ils prient, si l’on veut, ils sont musulmans à leur manière, ils ne vont pas vers d’autres chapelles, mais ils prient pour la galerie, et surtout, ce qui horripile le Prophète, ils ne donnent rien d’eux-mêmes :
Ils sont indécis (entre les croyants et les mécréants,) n’appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui.
Coran, IV, 143.
C’est contrariant mais c’est ainsi, les hommes sont divers, ondoyants, même ceux qui appartiennent à la communauté des musulmans.
Mais les pires ennemis, ceux qui méritent les pires châtiments, ce ne sont pas ceux qui croient différemment, qui se sont trompés de religion, ou qui persévèrent dans l’hérésie, ce sont ceux qui ont noué une alliance avec le Prophète et qui l’ont trahie. Puis, qui se retournent contre le Prophète et ses hommes. Dans ce cas c’est une question de vie et de mort, et il n’y a plus de tolérance qui tienne.
Ce qui provoque la violence du musulman, ce ne sont pas les croyances différentes, ce sont les dangers que font courir les groupes qui trahissent leur parole et qui sont manifestement hostiles. Trois versets prouvent ainsi que le djihadisme, le terrorisme moderne, sont de graves hérésies : 89, 90, 91. Ces versets distinguent ceux que le croyant doit combattre et ceux, parmi les ennemis, qu’il doit laisser tranquilles. Du moment que ces ennemis sont « neutres » et « offrent la paix », les musulmans ont l’obligation de les laisser vaquer. Mais les autres, ceux qui veulent vous avilir et vous faire quitter votre foi, ceux-là doivent être combattus sans relâche.
On assiste alors à des guerres de bandes, pour la survie des communautés. La vie n’était pas facile, on pouvait se faire attaquer à tout moment par les ennemis, à tel point que Dieu préconise des prières armées et à rotations :
Et lorsque tu (Prophète Muhammad) te trouves parmi les tiens, et que tu les diriges dans la prière, qu’un groupe d’entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis lorsqu’ils ont terminé la prosternation, qu’ils prennent place dans un rang arrière et que vienne l’autre groupe, ceux qui n’ont pas encore célébré la prière. À ceux-ci alors d’accomplir la prière avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodés par la pluie ou malades, vous déposez vos armes ; cependant prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant.
Coran, IV, 102
Les juifs et les chrétiens
Quelques versets s’adressent à ceux qui ont connu la vérité avant la descente du Coran et qui, évidemment, ont commis quelques impairs qui les ont conduits à fonder des religions qui ont eu tendance à s’écarter du droit chemin.
Ces gens-là qui ont compris que Dieu a crée l’univers, ils ont les mêmes références fondamentales que les musulmans, les mêmes valeurs, mais ils se sont égarés. Bon, Dieu conseille, les concernant, de les laisser tranquilles dans leur égarement, de les traiter avec respect et de les accueillir chaleureusement quand ils voudront se soumettre à Dieu seul et non pas à d’illusoires « associés » qu’ils lui ont inventés.
On appelle ces gens-là les « Gens du Livre » car l’islam considère que la Torah, la Bible et le Coran constituent un seul et même Livre qui diffuse la parole de Dieu à travers l’intercession d’anges et de prophètes.
Les hommes étant imparfaits, on l’a vu plus haut avec les mécréants et les musulmans qui n’arrivent pas à croire correctement, les juifs et les chrétiens ont travesti, perverti les mots du Livre soit par erreur, soit par malice :
Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens, et disent: « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi », « Écoute sans entendre », et « favorise-nous »: Ils font un mésusage du mot « Ra’inâ », tordant la langue et ainsi attaquent la Religion.
Coran, IV, 46
Pour les Chrétiens, de même, c’est Dieu qui décidera ce qui leur arrivera après la mort, les croyants n’ont pas à s’en occuper, et certainement pas à faire pression sur eux. Il faut les respecter comme Hegel respectait Descartes : certes ils ont tout faux, mais ils ont fait un pas dans la bonne direction. La sourate IV se borne à leur faire un simple rappel sur l’unicité de Dieu, après quoi, qu’on les laisse en paix :
Ô gens du Livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion, et dites plutôt la vérité à propos de Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, est un Messager de Dieu. (…) Et ne dites pas « trois », arrêtez cela, ce sera meilleur pour vous. Dieu est Un. Il est trop glorieux pour avoir un enfant.
Coran, IV, 171
Les dernières paroles de la sourate concernant les Chrétiens puis les croyants sont assez apaisés. Le Coran ne préconise ni n’approuve d’agressivité dirigée contre des non-musulmans qui sont le fruits d’égarements séculaires. Il y a assez à faire avec tous ceux qui, parmi les nouveaux venus dans la religion monothéiste, doivent être recadrés, récompensés, santionnés et tancés. Les autres, les Gens du Livre, qu’ils se débrouillent avec leur version du Livre. En revanche, ils savent que la porte leur est ouverte s’ils décidaient un jour de « dire la vérité à propos de Dieu ».
C’est la profession de foi de l’islam. Vous déclarez que Dieu est unique et vous voilà musulmans.
La sourate se termine enfin par un verset qui fait retour sur les parts d’un héritage. Pour une personne qui meurt sans enfant, tant revient à sa soeur, tant pour un frère, tant pour deux soeurs, etc.
Il y a une logique profonde à combiner la question des femmes et des enfants d’un côté, et celle des différents niveaux de scission avec le Prophète de l’autre. Le trait d’union entre les deux problématiques, c’est l’héritage. Dieu nous confie un Bien, nous en avons tous une part. Il n’y a pas d’égalité entre ce qui nous est confié, mais nous avons tous assez de liberté, d’autonomie et de pouvoir pour en faire un usage qui permettra à notre bien de fructifier, ici-bas comme après la mort.