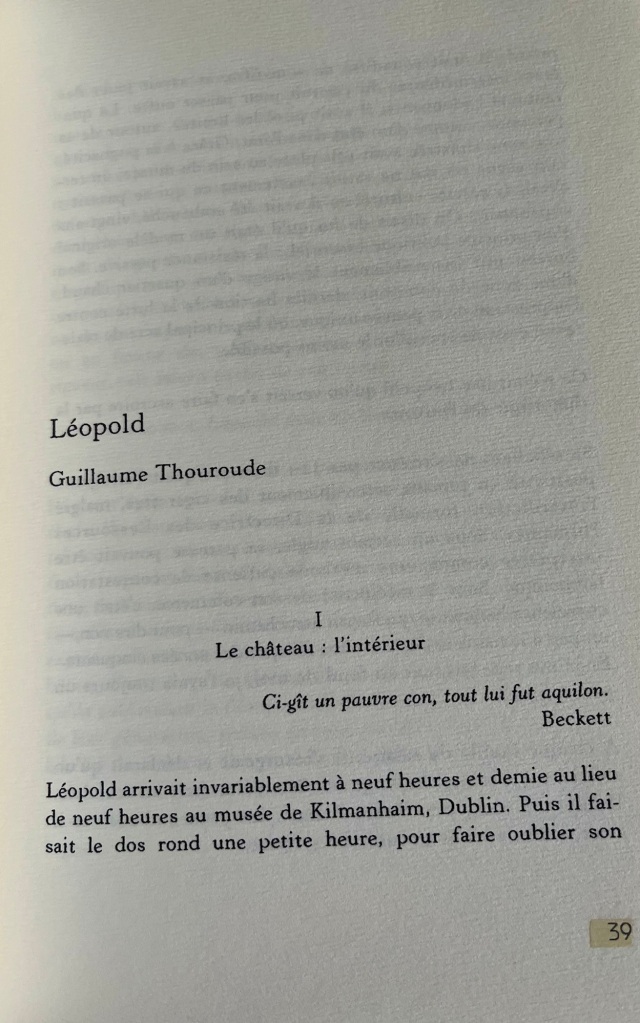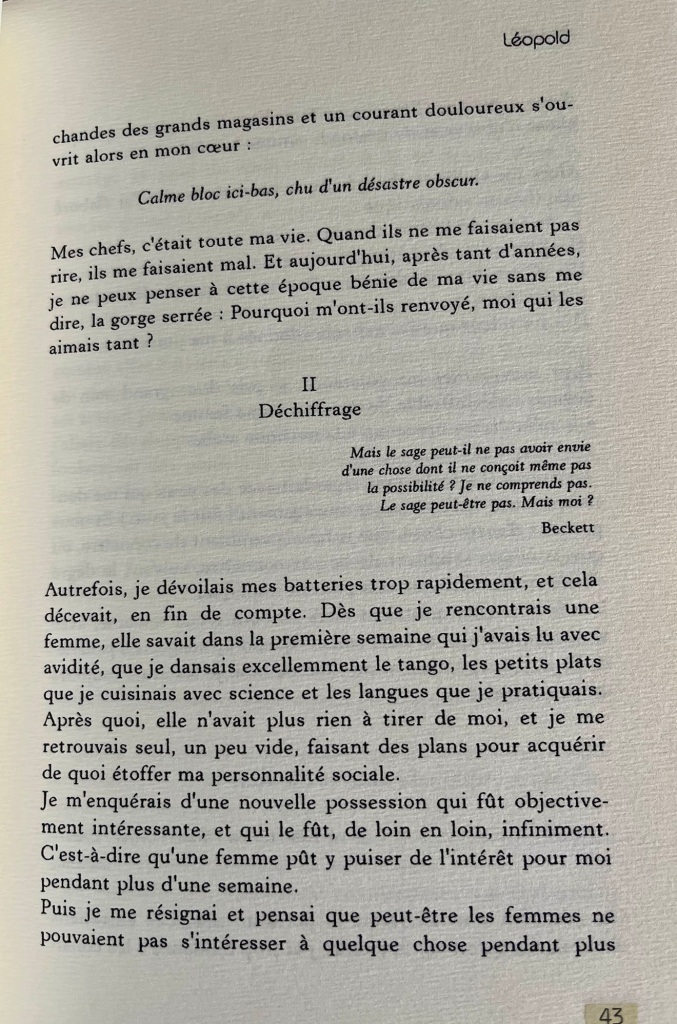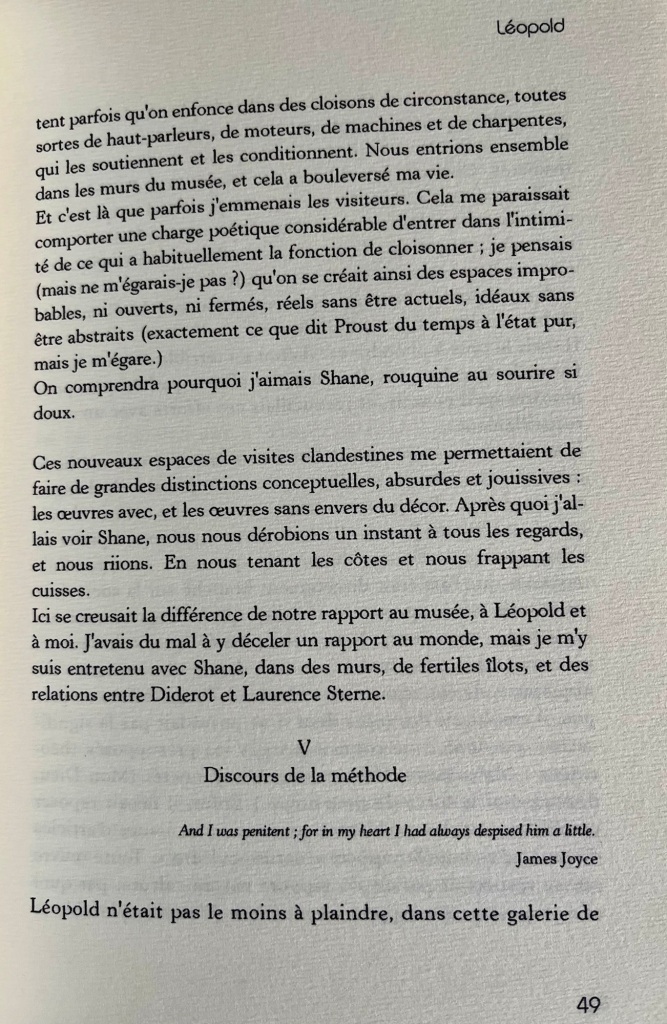Je lis Les Trésors de la mer rouge de Romain Gary, un récit de voyage publié en 1971, probablement sous forme de reportages calibrés pour une presse de qualité.
Outre le talent hors norme de l’auteur célèbre, on y découvre un européen un peu obligé de verser dans des clichés orientalistes selon lesquels l’islam se définit par la conquête plutôt que par une recherche spirituelle :
De ces rives sont partis les conquérants du Maghreb et de l’Espagne, et chaque rayon étincelant du soleil évoque les sabres des cavaliers du Prophète.
Romain Gary, Les Trésors de la mer rouge, p.32.
Même la prière n’y est pas envisagée comme une élévation, ni même comme un prosaïque besoin de sérénité, mais comme une passion délirante et pathétique, ainsi qu’il sied aux âmes frustes :
La prière musulmane y prend un accent désespéré. Elle monte de tous les coins de rue : le Mourad, aidé par la griserie du kat qu’à défaut de haschisch on distribue aux fidèles, atteint à cette joie dans la lamentation que connaissent bien tous les amoureux de l’Islam…
Romain Gary, Les Trésors de la mer rouge
Le récit augmente en intensité quand Gary rencontre des individus et raconte des lambeaux d’histoires singulières. Des histoires de soldats car il est clairement bordé (embedded) par l’armée française à Djibouti dans un premier temps. Il rappelle souvent qu’il a combattu dans « l’autre armée » dans le cadre de « l’autre guerre ». On comprend vite que Romain Gary préfère les combats pour la liberté que ceux qui visent à coloniser. Mais il reste en 1971 un gaulliste sans tolérance pour la jeunesse maoïste. Le ton qu’il emploie rappelle celui des réacs qui sont passés tranquillement de la gauche à la droite au fur et à mesure que le système en place les a favorisés économiquement. Gary approche de la soixantaine quand il voyage en Arabie.
Le lecteur comprend soudain à quelle époque il vit quand il s’extrait brutalement du climat orientaliste où les Arabes sont d’éternels guerriers. Gary se réveille en une époque contemporaine qu’il ne comprend pas, mais dont il emploie les contrastes pour nourrir une littérature de chocs :
En entrant dans la cahute pour voir comment vivent ces contemporains des premiers hommes sur la Lune, je trouve assis par terre, en train de jouer d’une flûte de berger dankali, un hippie aux cheveux roux, des jeans, une chaîne composée de signes du Zodiaque, l’insigne de la paix sur un médaillon autour du cou.
– Qu’est-ce que vous êtes venu foutre ici ?
– Rien.
– Bon. Mais enfin pourquoi ?
Il réfléchit. Des taches de rousseur. Il ressemble à Huckleberry Finn :
– J’ai voulu partir loin.
(…) On les ramasse par milliers à demi morts au Népal, au pied du Kilimandjaro, sur les bords du Gange…
Romain Gary, Les Trésors de la mer rouge, 50-51.
Les hippies et les astronautes, oui, nous sommes bien dans le monde incompréhensible des années 1960.
Puis il rencontre un « petit instituteur » qui fait œuvre de sainteté dans un village reculé. Non seulement le jeune expatrié enseigne avec peu de moyens, mais il soigne, il nourrit, il sauve des âmes. Dans ce cas de figure, le grand écrivain veut bien admirer la force progressiste de la gauche. Tant que les révolutionnaires se sacrifient, ne gagnent rien, souffrent et meurent dans l’altruisme le plus austère, les bourgeois comprennent et respectent.
Vous savez ce que vous faites ici, petit instituteur d’Arcachon ? La révolution. La vraie. Pas celle des putes verbales à la Cohn-Bendit. (…) Alors si vous devez nous fiche en l’air, je suis de tout cœur avec vous, parce que je sais, j’ai vu ce que vous voulez, je suis de tout cœur avec vous, même si le monde que vous voulez bâtir ne peut l’être que sur mon dos.
Les Trésors de la mer rouge, p. 58-59
Les « putes verbales » d’aujourd’hui apprécieront.