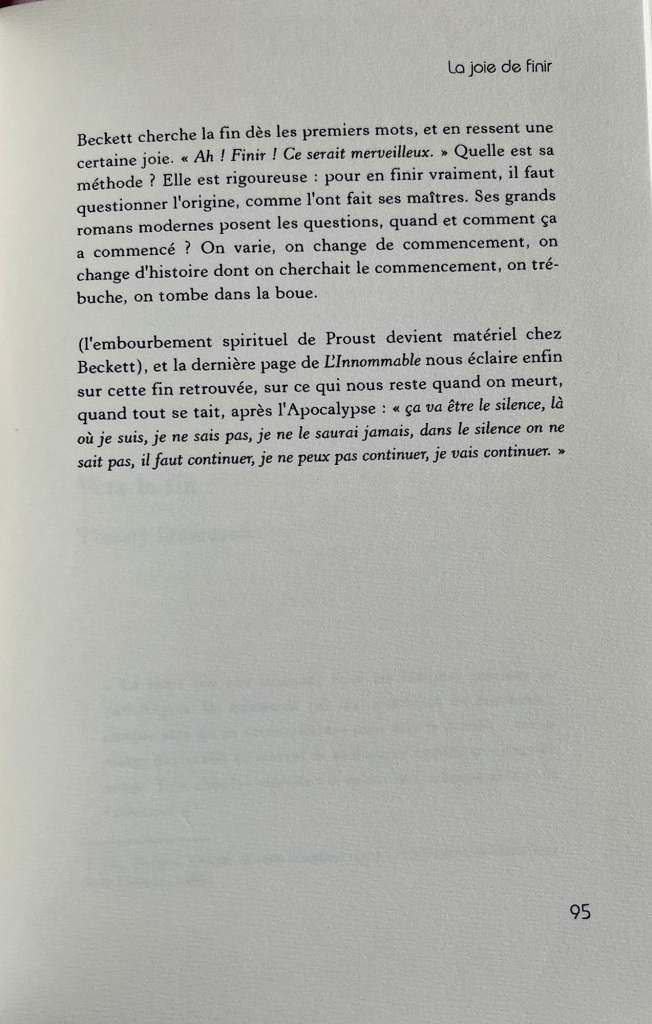C’était dans l’excellente revue de littérature Lieu-dit, publiée à Lyon et diffusée dans toute la francophonie. Feuilleter les numéros parus au tournant du siècle, avant l’avènement d’Internet, est une expérience sensorielle puissante.

De beaux efforts de graphisme une recherche constante de la matérialité la plus adéquate.
Le texte que j’ai écrit pour eux s’intitulait « Léopold » car c’était le nom du personnage principal de la nouvelle. Il travaillait au Musée d’art contemporain de Dublin.
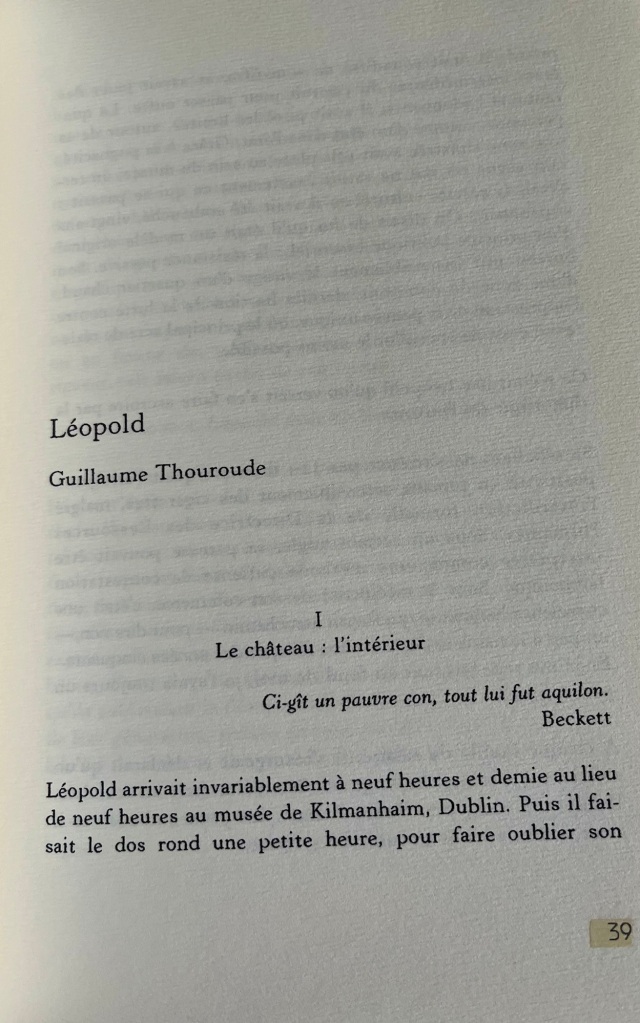
Il partageait son prénom avec le héros d’Ulysse, le roman de James Joyce que je lisais avec avidité lors de mes premiers mois en Irlande.
Je n’aurais probablement jamais lu Joyce si je ne m’étais pas expatrié à Dublin à la fin du siècle dernier. C’est cette expérience d’exil et d’émigration qui m’en a donné l’énergie.
Dissimulé derrière Joyce et Beckett, l’histoire littéraire et une délocalisation opportune, je pouvais me moquer du responsable du Musée de Lyon qui m’avait fait perdre mon emploi quelques mois plus tôt. Derrière Léopold gisait R., que le milieu culturel lyonnais reconnaissait aisément.

Perdre cet emploi au Musée d’art contemporain de Lyon avait constitué un traumatisme en moi car l’injustice était criante. Les chefs reconnaissaient que j’avais fait du bon travail, mais ils désiraient recommencer avec une équipe toute neuve. Ils profitaient de la précarité de notre statut pour se débarrasser de nous et former de nouveaux vacataires bien soumis.
Le pire était qu’ils se prétendaient de gauche et qu’ils nous reprochaient de ne pas manifester avec la CGT.
Moi, à 24 ans comme à 50, j’étais trop pauvre pour manifester. Le sage précaire n’a pas les moyens d’être de gauche. Léopold, lui, était payé chaque mois, il pouvait bavarder toute la journée au service culturel. Moi je devais jongler avec plusieurs emplois, ramoneur et médiateur culturel notamment, pour m’en sortir.
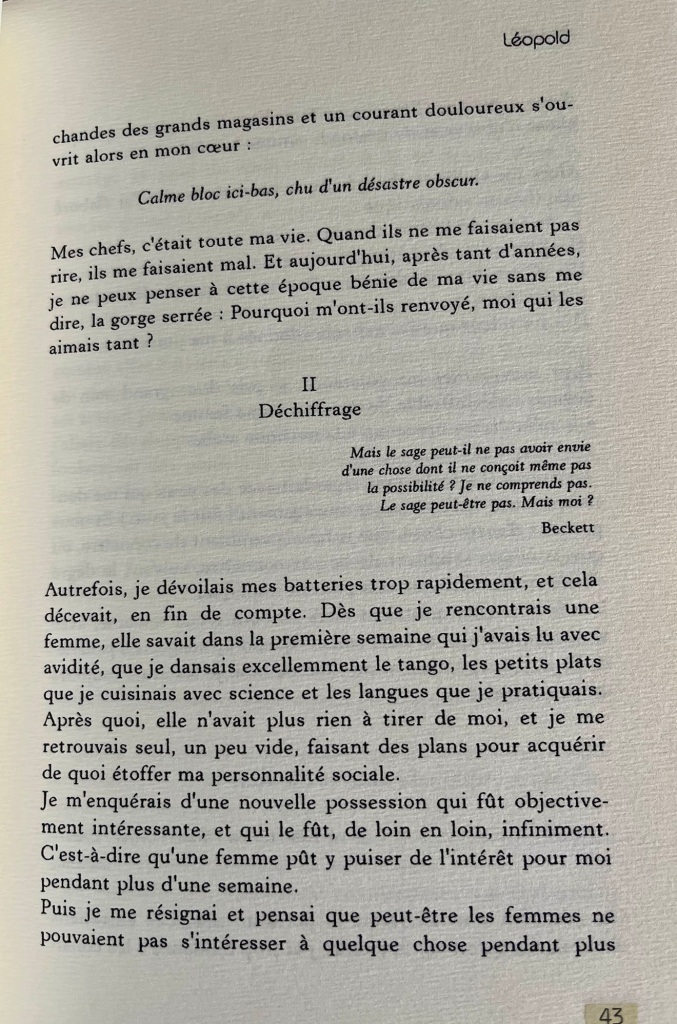
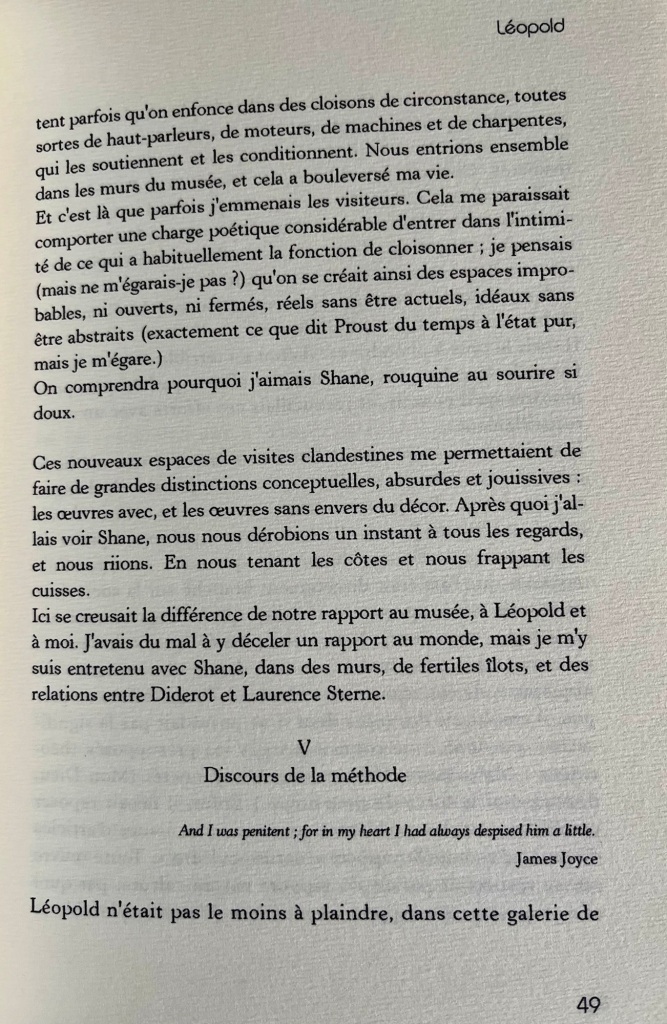

Le jour où il m’a viré, moi et les autre camarades animateurs-conférenciers, Leopold n’en menait pas large, pour lui c’était un mauvais moment à passer. Je lui ai dit en face : « Que penseraient tes amis de la CGT de ce que tu es en train de faire ? On n’a fait aucune faute professionnelle et tu nous jettes. C’est ça ta morale de gauche ? » On m’a dit plus tard que ma défense l’avait affecté.
Cette première publication fut l’occasion pour moi de mettre en forme et de sublimer la colère qui m’habitait. La joie que j’ai ressentie en voyant ce numéro de Lieu-dit n’a jamais été égalée depuis par aucune autre publication.