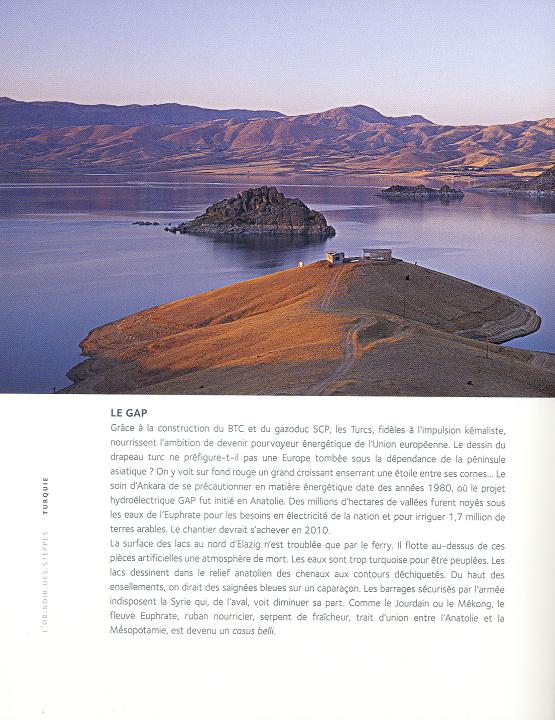Le vendredi, j’aime bien acheter Le Monde, pour son supplément littéraire qui s’est franchement amélioré depuis peu. Le Jeudi, c’est le jour du supplément littéraire du Figaro, et si je l’achète moins, il m’arrive de le lire quand, d’aventure, je me trouve dans une commune dotée de marchands de journaux. Vivre en France, selon moi, c’est aussi lire la presse française, et particulièrement, suivre l’actualité littéraire.
Le dossier du dernier Figaro littéraire, donc, a tout pour m’intéresser. Il est consacré à la littérature du voyage, avec en première page une grande photo de Thomas Goisque montrant Sylvain Tesson, au bord du lac Baïkal, sautant par-dessus une rivière ou une craquelure dans le lac glacé. La photo est malheureusement annonciatrice de la relative faiblesse du dossier : contemplé par ses deux jolis chiens à l’arrière plan, Tesson porte la barbe et une écharpe négligemment passée autour du cou, une casquette vissée sur le crâne et une paire de jumelles sur le côté. Chaussures de marche légères et gants, son sac à dos ne l’empêche pas d’évoluer dans les airs. Les bras écartés vers l’avant, l’écrivain voyageur fait à la fois figure d’oiseau et d’enfant qui tend les bras vers un nouveau monde. Le visage est impassible, concentré, des rides sur le front marquent le souci de l’aventurier quant à l’endroit où il posera son pied.
(Goisque et Tesson ont fait plusieurs livres ensemble, dont un qui m’avait intéressé, le long des pipe lines de pétrole en Asie centrale. Les deux aventuriers lient leur carrière et s’entraident : le photographe profite de la célébrité de l’auteur pour se faire financer des voyages et obtenir des débouchés éditoriaux, tandis que l’écrivain s’offre, grâce à la présence d’un ami plasticien, une galerie de portraits qui contribuent à ériger une sorte de légende autour de sa personne. La parution, l’année dernière, de Sibérie chérie, un livre de photos et d’aquarelles des deux amis accompagnés d’un troisième compère, à la suite du grand succès de librairie Dans les forêts de Sibérie, participait de cette auto-mythologie des voyageurs.)
Qu’en est-il, alors, du « dossier » sur les nouveaux aventuriers ? En quoi sont-ils nouveaux, d’ailleurs ? En une phrase, la couverture du Figaro littéraire le dit : « Il n’y a plus de contrées à découvrir. Désormais, les voyages au loin se font aussi en profondeur. » Le constat date maintenant d’une bonne centaine d’années. Victor Segalen le disait au début du siècle, Valery et Michaux le disaient dans les années 1920, le Figaro littéraire n’impressionne pas le lecteur cévenol par son sens de l’innovation théorique !
En fait de « dossier », une double page composée d’un article principal de Sébastien Lapaque, d’une minuscule interview de Jean-Christophe Rufin, de trois courtes critiques de parutions récentes et de quelques brèves qui coiffent la double page. Ces brèves donnent un paragraphe d’introduction, un chiffre, une citation, et trois titres de parutions récentes. Le chiffre, c’est le nombre de visiteurs au festival « Etonnants voyageurs » (60 000 personnes), la citation parle de l’aventure, affirmant qu’elle « ne sert à rien » et que c’est là sa beauté. La phrase d’introduction, enfin, va un peu plus loin que la banalité affichée en page de couverture :
Quelques écrivains français donnent un nouveau visage au récit de voyage. Ces globe-trotteurs ne sont pas en quête d’exploits. Vagabonds lettrés, ils aiment mettre leurs pas dans ceux de leurs prédécesseurs pour se souvenir de que furent leurs émerveillements mais aussi leurs colères.
Là encore, le fait que le récit de voyage ne cherche plus sa valeur dans l’exploit, c’est une antienne que l’on rabâche depuis plus d’un siècle. Quand les auteurs, les lecteurs et les critiques vont-ils s’en rendre compte, et quitter cette idée reçue selon laquelle le récit de voyage est, par essence, un ramassis de racontars héroïques et auto satisfaits ? A cause de cette erreur de perspective, due à une ignorance de départ, les bons récits de voyage sont constamment accompagnés de remarques du type : « C’est bien plus qu’un simple récit de voyage », ou même : « contrairement aux apparences, ce n’est pas un récit de voyage », tant il est vrai que le genre a perdu toutes ses lettres de noblesse au cours du XXe siècle.
Deuxième cliché, le terme même de « vagabonds ». Après son occurrence dans le petit paragraphe d’introduction, on en trouve une seconde dans le chapeau de l’article : « Nos globes-trotteurs parcourent le monde en vagabonds métaphysiques et cultivés. » Pourquoi user d’un mot aussi galvaudé ? Ces écrivains voyageurs sont d’ailleurs tout sauf des vagabonds. Ils sont des entrepreneurs, ils travaillent, ils font des projets, ils savent trouver des financements, ils ont des réseaux… Ils n’ont rien d’errants rêveurs.
Vient alors la thèse de l’article : il existerait une « spécificité » française du récit de voyage qui consiste à abandonner l’exploit pour produire des « aventuriers métaphysiques et des vagabonds instruits ». En quoi sont-ils métaphysiques ? On ne le saura pas. En quoi sont-ils instruits ? En ceci qu’ « ils aiment mettre leur pas dans ceux de leurs prédécesseurs pour se souvenir de ce que furent leurs émerveillements (et leurs colères). » De quelles colères parle-t-on ? On ne le saura pas non plus. Et de citer le dernier livre de Sébastien Courtois, au titre banal et étonnamment naïf, Éloge du voyage. Sur les traces d’Arthur Rimbaud.
Le journaliste aurait pu en effet rappeler d’autres récits de ce type qui, depuis vingt ans au moins, montre que c’est devenu un sous-genre en soi, avec le récit d’Olivier Weber sur les pas d’Ella Maillart, le film de Priscilla Telmon sur les traces d’Alexandra David Néel, le livre de Sylvain Tesson reprenant l’itinéraire des échappés du goulag à travers l’Asie centrale, ou l’album récent d’Ingrid Thobois sur les chemins de L’Usage du monde de Nicolas Bouvier.
Mais la question qu’on peut se poser est double. En quoi est-ce nouveau et en quoi est-ce spécifiquement français ? Nouveau, je viens de l’indiquer, ce ne l’est peut-être pas tout à fait (mais cela pourrait être quand même un phénomène assez récent, il faudrait chercher…) Et français ? En quoi ces récits « sur les traces de » sont-ils plus français qu’américains, italiens ou russes ? M. Lapaque, l’auteur de l’article, postule que c’est un trait national, mais sans aucune apparence de preuve. C’est la pauvreté de ce journalisme littéraire, qui assène, qui postule et qui statue du haut d’une supériorité autoproclamée, prenant les lecteurs pour une masse inculte.
Ce serait pourtant extrêmement intéressant d’en savoir plus sur le sous-genre des livres « sur les traces de » ! Si cela se trouve, c’est une habitude que l’on retrouve dans les pays latins mais pas chez les autres.
Ou alors dans les pays colonisateurs, qui ont produit davantage d’orientalistes et d’explorateurs.
Ou alors dans les pays qui ont tendance à vouer des cultes aux morts (Chine).
Ou bien c’est une tradition typiquement française, et alors là, je dis que c’est fascinant et que ça mérite d’être creusé. Nous méritons d’être informés, en fait, voilà la simple vérité. Mais le journaliste nous laisse tout seuls avec cette hypothèse, qu’il lance comme une vérité communément admise : « On s’autorise à distinguer une spécificité des écrivains voyageurs français. » Vous vous autorisez ? Mais moi j’ai acheté ce journal plus d’un euro, monsieur, j’aimerais que vous fassiez un peu plus que vous « autoriser » à distinguer.
Il manque au journalisme littéraire de la grande presse le minimum de scrupule intellectuel qui le rendrait digne d’être lu. Il faudrait, je pense, que journalistes et pigistes fassent preuve d’un esprit de recherche, au moins élémentaire. Je ne demande pas qu’ils écrivent des thèses, mais qu’ils s’informent un minimum, dans le champ universitaire par exemple, pour éviter de remplir des pages de poncifs.
On parle toujours de la crise de la presse, mais relever la qualité du journalisme pourrait être une première méthode pour s’en sortir. Demander aux journalistes en charge des pages littéraires de se renseigner avant d’écrire, cela pourrait peut-être aider la presse écrite à trouver des lecteurs, on ne sait jamais.