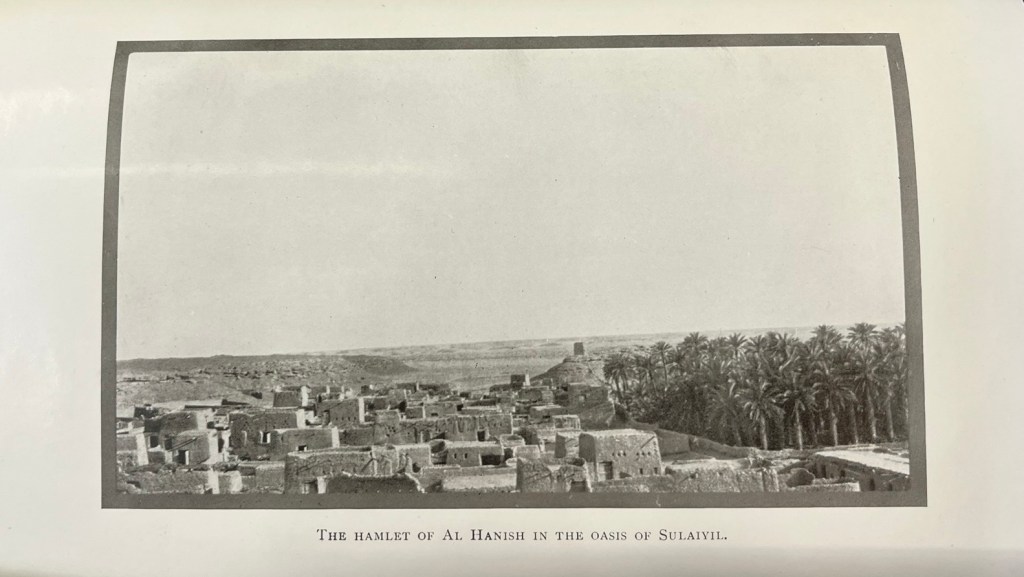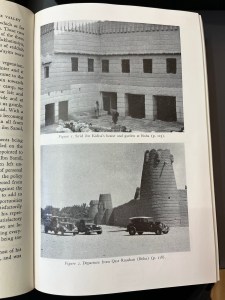Hier après-midi, à Munich, la marche contre le racisme du 22 mars s’est tenue dans un centre-ville animé, où il était parfois difficile, au vu des divers accoutrements, de distinguer les différents rassemblements : manifestations pro-LGBT ou enterrements de vie de jeune fille. Nous avions du mal à déterminer où se trouvait le rassemblement, jusqu’à ce qu’on voie des drapeaux arc-en-ciel floqués d’un message écrit qui stipulaient qu’il s’agissait d’événements liés à la « Semaine Internationale contre le Racisme ». Nous avons décidé d’y participer, ma femme et moi, mais notre action s’est bornée à marcher de Karlplatz jusqu’à la rivière Isar.
Bien sûr, être contre le racisme va de soi, mais comment ne pas ressentir un malaise en voyant, sur l’hôtel de ville de Marienplatz, flotter le drapeau israélien ? Comment ignorer que Munich est une ville où des militants pour les droits des Palestiniens ont été arrêtés, où le soutien à un État dont la politique repose sur une discrimination systémique n’est jamais remis en question ? Avec ce qui vient de se passer en Israël, afficher un tel soutien inconditionnel tout en prétendant marcher contre le racisme relève presque de la provocation.
Être contre le racisme, c’est aussi refuser les amalgames et les discours qui visent à stigmatiser une partie de la population sous couvert de lutte contre l’extrémisme. Depuis des années, nous voyons se répandre des discours sur un prétendu entrisme des Frères musulmans, utilisés comme prétexte pour cibler et persécuter les musulmans dans l’espace public. Si l’on veut être sérieux dans la lutte contre le racisme, alors il faut avoir le courage de dire clairement que la distinction entre islamistes et musulmans ne doit pas être un outil de discrimination.
Il est évident que la violence et le terrorisme doivent être combattus sans relâche. Mais si un islamiste – tant qu’il ne prône pas la violence – n’a pas le droit à la parole, alors qu’en est-il des catholiques intégristes, des fondamentalistes protestants ou des témoins de Jéhovah ? Qu’en est-il de ceux qui acceptent les paroles dégradantes concernant les Palestiniens de Gaza ? Une démocratie qui se veut cohérente doit appliquer les mêmes principes à tous.
Alors oui, marcher contre le racisme, mais pas sans lucidité. En plein ramadan, marcher fait du bien dans le soleil froid de Munich, mais n’est pas très facile. Nous nous sommes assis sur un banc pour regarder passer les promeneurs. Pour nous, c’était à la fois une marche et un sit-in contre le racisme. Arrivés à la rivière Isar, nous avons décidé d’aller voir le film Like a Perfect Unknown sur la vie de Bob Dylan.
Au final, Hajer et moi avons milité toute la journée pour la république. À la fin du film, l’heure de la prière du soir était déjà passée. Nous avions jeûné une heure de plus que tous les autres musulmans. Si ce n’est pas du militantisme, ça !