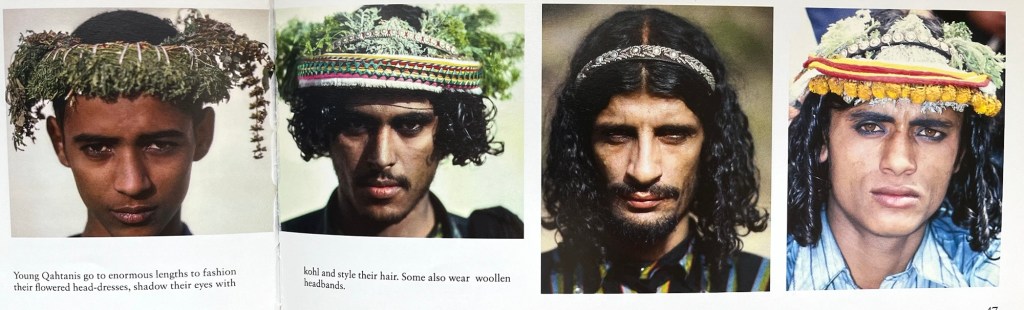Intéressé d’en savoir plus sur les Bédouins, j’ai eu la chance de rencontrer un ami à Tabuk qui m’a proposé de m’emmener voir un paysage stupéfiant, à quelques heures de route : le Wadi Disah.
Il m’a dit qu’il y avait de l’eau.

On peut nager ?
لا، الماء سطحي جدًا، فقط منظر جميل.
(Non, me dit-il, l’eau est trop superficielle, juste belle à regarder.)
Il devait de toute façon conduire sa mère voir une amie dans le coin, et peut-être que ses enfants viendraient aussi. Résultat : nous voilà partis tous les trois, lui au volant, sa mère à l’arrière, moi entre deux mondes.
Sa mère aime parler. Elle rit, taquine son fils, me pose des questions. À un moment, elle me complimente sur mon arabe, avec ce ton attendri qu’on réserve aux enfants quand ils ont dessiné une horreur sur une feuille.
ما شاء الله، تتكلم عربي ممتاز!
(Machalla, dit-elle, tu parles arabe superbement!), mais je sais très bien que « ممتاز » (Mumtaz, superbe) veut dire en l’espèce : « c’est mignon d’essayer ».
Nous nous arrêtons quelque part entre deux montagnes pour déposer la maman. Elle disparaît derrière un mur de pierre, avalée par le paysage. Alors commence une autre scène : on s’installe sous une tente bédouine, sur des coussins aux couleurs à dominante rouge.

On me présente le chef de cette famille, Saleh, qu’on appelle Abu Mahdi — le père de Mahdi. Sa poignée de main est ferme, son regard calme. Il parle peu, car il sait que je comprends peu et ne peux exprimer que très peu.
Nous attendons longtemps, très longtemps. Je pense à plusieurs hypothèses, puis je comprends : on a tué une chèvre à l’annonce de notre visite. Le temps de la préparer, de la bouillir, et de prévenir des convives du villages, il s’est écoulé une bonne partie de la journée. Et quand enfin on nous sert ce festin, non pas sous la tente mais dans un salon où l’on s’assoit par terre, je ressens à la fois la générosité et la gravité de ce geste : une hospitalité qui se mesure en vie donnée.
La chèvre est découpée sur un gros tas de riz parfumé jonché de galettes de pain qui semblent aussi être bouillies et non cuites au four. Un seul plat gigantesque autour duquel nous mangeons à la main. Tout est de couleur blanchâtre et la consistance glutineuse du riz facilite cette manière de table : on se forme des boules de riz dans la paume avant de la porter à la bouche.
Quand nous terminons et allons nous laver les mains et la bouche, les jeunes hommes entrent dans le salon, s’assoient et continuent le repas. Il y en aura pour tout le monde et c’est un vrai festin.

Après le repas, nous reprenons la route du wadi, accompagnés d’Abu Mahdi, qui se proclame connaisseur du lieu. Notre 4×4 s’engage dans un couloir de sable et d’eau, l’un de ces passages où le désert hésite entre sécheresse et oasis. Les roues trempent dans de véritables mares, les roseaux s’écartent, des familles et des bandes de jeunes pique-niquent sous les palmiers et sur des rochers.
Je propose qu’on laisse la voiture pour marcher.
On me répond en répétant simplement ma demande, mais sans arrêter la voiture.

Le paysage est d’une beauté à laquelle je ne m’attendais pas : de hautes falaises dorées et rougeoyantes, des jeux de lumière sur le calcaire, un ciel bleu cru et, en contrebas, une verdure éclatante qui semble presque tropicale.
Abu Mahdi, malgré son âge, bondit hors du véhicule et commence à escalader une paroi. Il me dit :
تعال! اتبعني!
(Viens ! Suis-moi !)

Je le suis quelques mètres avant que le vertige ne m’arrête. Ce sexagénaire grimpe comme un jeune cabris. Il rit en me voyant hésiter, me lance une main solide, puis me montre du doigt une ouverture dans la roche.

Nous contournons la falaise, et soudain elle s’ouvre devant nous : une grande anfractuosité, creusée par l’eau depuis des millénaires. Une nef de pierre, une minuscule cathédrale naturelle, où la lumière filtre comme à travers des vitraux invisibles.







Je me dis que c’est sans doute pour ça que les Bédouins parlent peu.