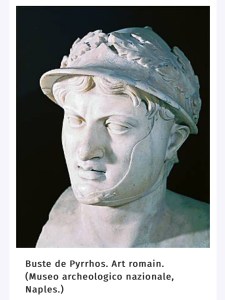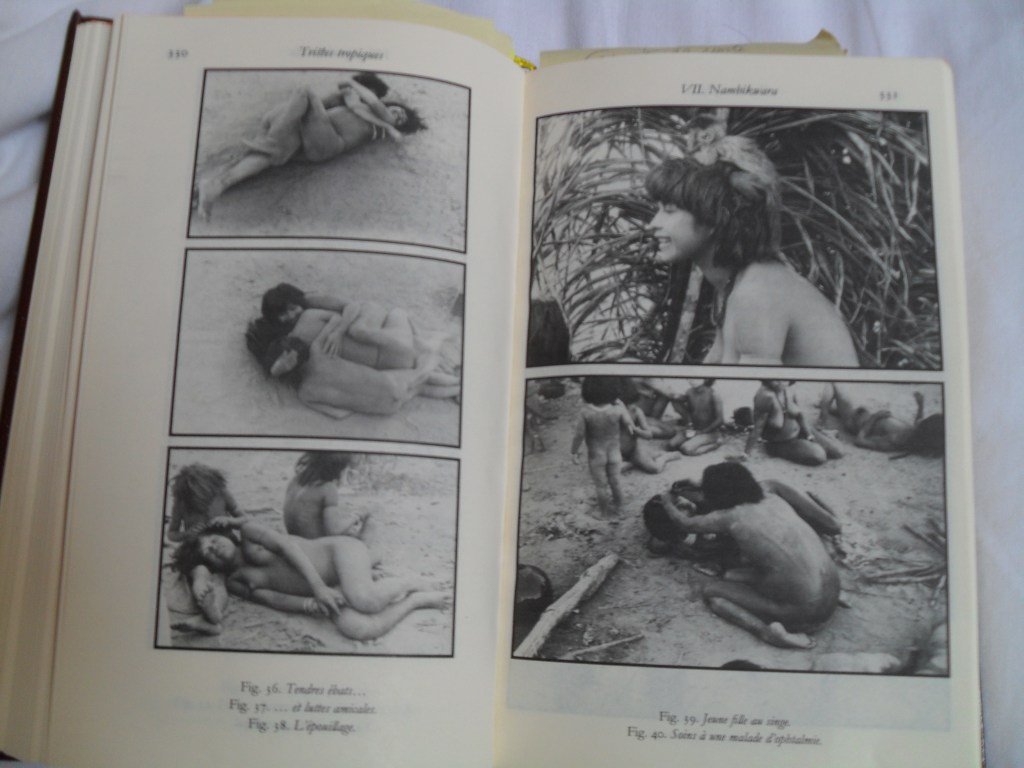Pourquoi le passage de Bob Dylan à l’électrique a-t-il fait scandale ? C’est une question qu’on évacue trop vite, à force de raconter l’histoire comme une rupture entre l’ancien et le nouveau, entre le folk et le rock. Pourtant, ce que symbolise ce moment dépasse largement une affaire de sons ou d’instruments. Il faut remettre les choses dans leur contexte et comprendre ce que représentait le folk à ce moment-là, et pourquoi ses adeptes ont pu se sentir trahis.
Quand Bob Dylan prend la guitare électrique et abandonne le combo guitare-folk-harmonica, il faut comprendre pourquoi ça a fait scandale. Le film de James Mangold et beaucoup de critiques font croire – ou feignent de croire – que la guitare électrique est à ce moment-là la modernité. Mais ce n’est pas vrai du tout. Quand Dylan décide de jouer de la guitare électrique, celle-ci est déjà utilisée depuis longtemps dans la musique populaire américaine.
Dès les années 1930, des musiciens de jazz et de blues jouaient sur des guitares électrifiées. Le rock’n’roll, lui, s’est imposé au début des années 1950, et la guitare électrique y occupe une place centrale dès le milieu de la décennie, notamment grâce à des artistes comme Chuck Berry. Quant à Elvis Presley, il commence sa carrière en 1954 avec That’s All Right, et devient une star en 1956 avec Heartbreak Hotel joué à la guitare électrique. Bref, cela faisait déjà plus de dix ans que cette musique électrique remplissait les ondes.
Il ne faut donc pas imaginer qu’il y a un « avant » un peu préhistorique avec les joueurs de folk, et un « après » plus moderne avec la guitare électrique. Ce n’est pas du tout le bon tableau. La réalité est différente. Il y avait d’abord de l’électrique, largement appréciée dans la musique noire américaine – dans le blues, le rhythm’n blues – avant que n’émerge ce que nous appelons, en France, le folk. En fait la musique folk est elle aussi ancienne puisqu’elle vient des immigrants de toutes parts, mais le mouvement dans lequel prend place Bob Dylan en 1960 est le « Folk revival », le renouveau folk qui s’inspire des chansons européennes et africaines traditionnelles et qui l’adaptent.
Et justement, l’arrivée de ce « renouveau folk », c’est un peu l’équivalent dans la musique populaire de la Nouvelle Vague dans le cinéma : une volonté d’appauvrissement volontaire, de retour à l’essentiel. C’est aussi comparable à l’Arte Povera en art contemporain : un choix esthétique et politique de se dépouiller des artifices. Le mouvement folk est un mouvement de contestation, non pas de l’électricité en soi, mais du capitalisme en cours, du pouvoir en place, de l’appareil industriel et militaire qui utilise l’énergie pour faire la guerre et broyer la vie humaine – ouvriers, soldats, étudiants.
La guitare folk, ce n’est pas le refus du progrès, c’est une tentative de produire un son nouveau, plus proche de la vie, plus en prise avec la nature. En 1960, le folk est quelque chose de jeune, pas une survivance du passé. C’est une manière de dire non aux grands orchestres de la chanson à succès. En France, on peut penser à Georges Brassens, qui monte sur scène avec une guitare et une contrebasse. Les gens de gauche adoraient ça.
Dans le folk, il y a cette idée d’une voix non transformée, naturelle, comme celle de Joan Baez, qui chantait pieds nus, avec une voix d’ange. Politiquement, les folkeux se voyaient comme minoritaires, marginalisés, méprisés par la bourgeoisie et le grand public formaté par la télévision. Ils formaient une communauté. Quand une voix étrange, nasillarde, comme celle de Dylan apparaît, ils sont contents de l’accueillir, justement parce qu’elle ne correspond pas aux canons esthétiques dominants. C’est pourquoi les adeptes du folk vont continuer à voir Bob Dylan comme l’un des leurs pour toujours. Regardez la vidéo qui suit et passez directement à la minute 10:30. On est en 1972 et Joan Baez chante avec des grands folkeux des montagnes californiennes, son bébé sur les genoux. Vous voyez les gens rigoler. Pourquoi ? Parce que Joan Baez imite l’accent et la façon de chanter de Bob Dylan, sur une chanson du premier album de Dylan. Sous-titre : dix ans après leur histoire d’amour, Baez et Dylan sont toujours associés dans les mémoires. C’est une manière émouvante à mon avis de rendre hommage à un ancien compagnon tout en se foutant de sa gueule.
Alors quand Bob Dylan passe à l’électrique, en 1965, ce n’est pas l’arrivée de la modernité : c’est une rupture perçue comme une trahison politique et esthétique. Non parce que les folkeux rejetaient l’électrique en soi mais parce qu’ils craignaient que Dylan cède à l’industrie, qu’il renonce à la communion vertueuse des luttes pour se soumettre aux lois du marché.
Et puis ils se disaient : d’accord, ce petit con prend le succès que nous lui avons donné avec notre rigueur morale, il prend la poésie militante qu’il a trouvée chez nous, et il va donner tout ça à des capitalistes pour aller faire danser des Blancs pleins de pognons dans des drugstores rutilants.
Le scandale était donc plus politique qu’esthétique, plus une lutte de valeurs qu’un conflit de générations. En 1965, les uns chantaient la guerre du Vietnam et l’injustice sociale avec des guitares acoustiques ; les autres faisaient danser la bourgeoisie blanche sur des histoires d’amour avec orchestre électrifié. C’est cette ligne de fracture qui explique le choc provoqué par la « trahison » de Bob Dylan en 1965.
Ce qu’a décidé de faire Dylan, c’est plutôt de prendre une tangente que personne ne voyait venir. Une musique et des paroles déstructurées, où le sens se dissout et la danse se ramollit.
Malheureusement, le film de James Mangold n’a pas montré cela de manière convaincante. Toute cette problématique est concentrée sur un seul personnage, Pete Seeger, qui est trop sanctifié pour être vraiment puissant. Le spectateur part avec l’idée que Bob Dylan était un génie révolutionnaire et les autres des tacherons sympathiques, et cela n’est ni vrai ni intéressant.