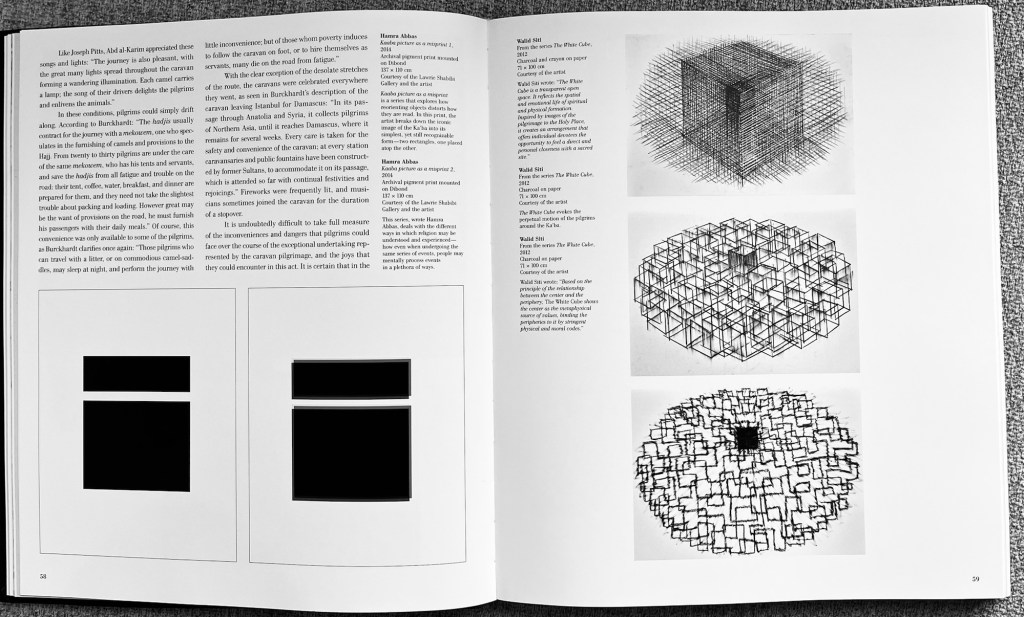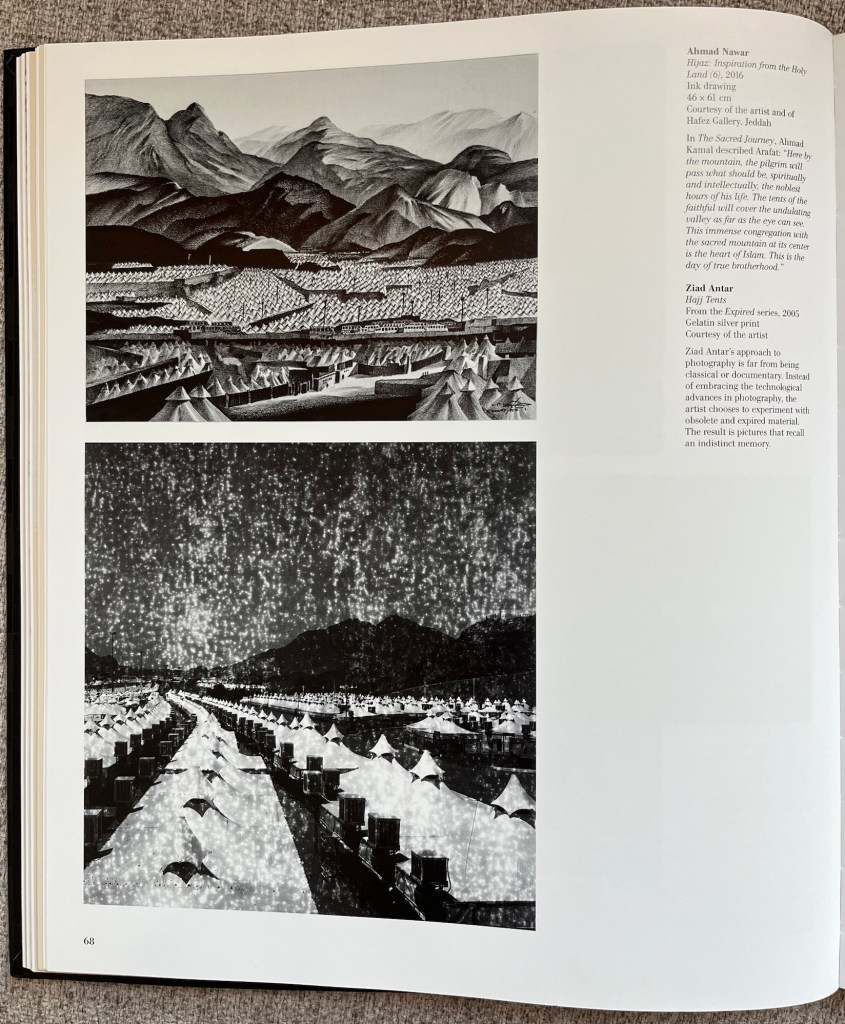À Riyad, un nouveau musée a récemment ouvert ses portes que nous avons visité pendant nos récentes pérégrinations arabesques : DAF (Diriyah Art Futures).
Situé à Diriyah, berceau historique du royaume saoudien, ce lieu combine passé et futur. Diriyah, avec son palais historique du XVIIIe siècle, est une ville chargée d’histoire. À quelques pas de ces ruines, le ministère de la Culture a choisi d’implanter un musée d’art contemporain tourné vers l’avenir.
La première exposition, intitulée “Art Must Be Artificial”, explore les intersections entre art, numérique et intelligence artificielle. À travers des œuvres pionnières, elle propose une sorte d’archéologie des futurs possibles, nous plaçant en observateurs d’un présent déjà empreint des marques du futur. C’est un projet ambitieux et conceptuellement intrigant.
Une scénographie impressionnante, mais…
Le musée lui-même est une œuvre. L’architecture est remarquable, les volumes spacieux et les scénographies parfaitement exécutées. L’expérience visuelle et sensorielle est indéniable. Pourtant, une question essentielle m’a habité tout au long de ma visite : où est l’émotion esthétique ?
En tant qu’amateur d’art contemporain depuis les années 1990, j’ai souvent été confronté à des œuvres technologiques ou interactives. La première Biennale de Lyon dont je me souviens concernait justement les nouvelles technologies et c’était bien avant internet puisqu’elle devait avoir lieu autour de 1995.
Mais ici, devant ces installations numériques, une impression domine chez moi : l’absence de véritable profondeur émotionnelle. Les œuvres, bien qu’intéressantes sur le plan conceptuel, semblent souvent dépassées dès leur apparition, tant les technologies vieillissent rapidement.
Interaction ou distraction ?
Un exemple marquant est une œuvre interactive datant des années 2000. Elle propose un paysage stylisé où les arbres et les fleurs bougent en fonction des déplacements du spectateur. Certes, c’est ludique, et probablement captivant pour des enfants. Mais en tant qu’adulte et médiateur culturel, cette interaction m’a laissé le cœur froid.
Un détail révélateur : l’une des médiatrices m’a affirmé que l’art interactif est « supérieur à l’art non interactif ». Une déclaration péremptoire qui soulève des questions sur la manière dont ces œuvres sont présentées au public. L’interaction, bien qu’amusante, ne suffit pas à créer une émotion artistique durable.
Une fétichisation des nouvelles technologies
Cette exposition illustre une tendance générale : la fétichisation des nouvelles technologies dans les mondes culturels et éducatifs. Depuis les années 1990, j’observe comment l’art numérique, bien qu’impressionnant sur le moment, peine à susciter une véritable connexion esthétique.
Cela me rappelle cette première Biennale d’Art Contemporain dont j’ai parlé, il y a trente ans, qui explorait les débuts de l’Internet et des questions cybernétiques. Certaines œuvres étaient conceptuellement intéressantes, mais beaucoup ont déçu les Lyonnais, qui sont il est vrai des gens faciles à décevoir.
Une réflexion nécessaire
En visitant DAF en Arabie saoudite, je suis ressorti partagé. Le musée et son architecture sont des réussites incontestables. L’exposition, quant à elle, interroge notre rapport à l’art, à la technologie et au futur. Mais elle met aussi en lumière un défi fondamental : comment les nouvelles technologies peuvent-elles transcender leur dimension ludique, enfantine et même puérile ?
Pour l’instant, je reste en quête d’une œuvre numérique ou générée par intelligence artificielle que l’on pourrait qualifier de chef d’œuvre, et qui pourrait me faire réfléchir, m’émouvoir ou me faire rire.
En attendant, le musée reste une visite incontournable, ne serait-ce que pour son cadre extraordinaire et son ambition de questionner les futurs possibles de l’art.