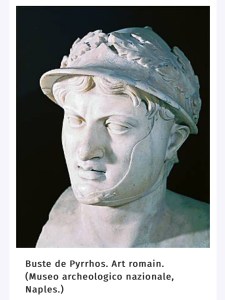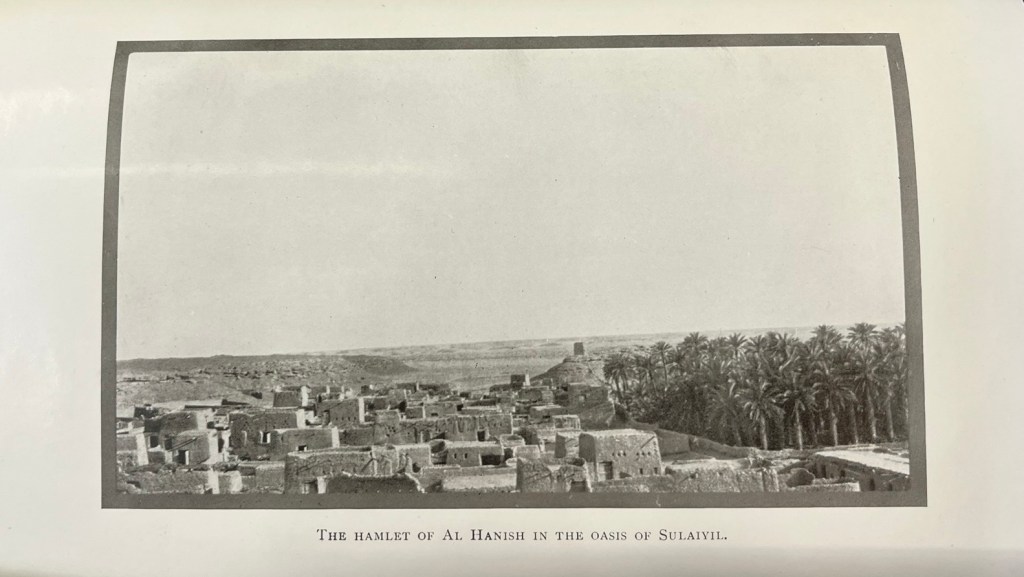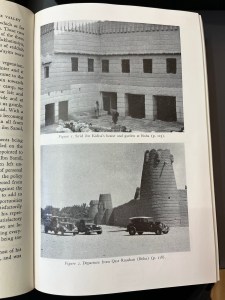Dérive psychogéographique dans la banlieue orientale de Paris, entre Vincennes et Montreuil. C’est une promenade extraordinaire, un vrai passage d’un monde à un autre, une traversée anthropologique. J’ai quitté mon petit hôtel pas cher le matin pour marcher jusqu’au centre-ville de Montreuil, puis descendre vers Vincennes pour des raisons administratives. Après quoi, retour à pied à mon hôtel pour faire une sieste avant la séance de cinéma du soir.
J’ai visité le château de Vincennes qui m’a permis de mieux connaître Charles V, un des rois de France que je ne connaissais pas bien, malgré plusieurs choses qui auraient dû m’attirer chez lui, notamment sa collaboration avec le grand musicien Guillaume de Machaut et l’écrivaine Christine de Pisan.

On quitte Vincennes, ville proprette et sage, ses façades bien entretenues, ses petits commerces bien alignés. On longe ses rues impeccables, où tout semble avoir été soigneusement pensé pour offrir un cadre de vie agréable, policé, gentiment bourgeois. Et puis, doucement, sans transition brusque mais avec une sensation de glissement progressif, on entre dans Montreuil. Là, l’ambiance change. La ville se fait plus broussailleuse, plus diverse, parfois plus bordélique.

La population elle-même se métamorphose sous nos yeux : on passe d’un monde majoritairement blanc à une mosaïque urbaine bien plus bigarrée. Il y a des rues où dominent les commerces africains, d’autres où l’on croise une majorité maghrébine, et puis ces lieux hybrides où tout se mélange sans effort, sans tension apparente.
Mais le plus drôle, et sans doute le plus impressionnant, c’est quand on débouche sur la place de la République, à Montreuil.
La place de la République : un décor de film sur la diversité


Quand mon copain Mathieu me l’a fait découvrir il y a vingt-cinq ans, elle n’avait rien de particulier. Une place quelconque, un espace urbain sans âme. Aujourd’hui, c’est un tout autre tableau. Une mise en scène quasi parfaite du “vivre-ensemble”, comme on pourrait le voir dans une publicité de La France Insoumise ou dans une comédie romantique anglaise pleine de bons sentiments.

Des arbres, des fleurs, des bancs, des tables de ping-pong, des endroits pour s’asseoir, d’autres pour rester debout, comme si tout avait été conçu pour que chacun puisse y trouver sa place, littéralement et métaphoriquement. Une sorte de tiers-lieu grandeur nature, ni vraiment parc, ni vraiment place publique, mais un entre-deux où la ville semble s’être installée pour respirer.

Et les habitants ? Une incroyable « diversité » pour reprendre un mot à la mode. Voici comment elle m’est apparue, cette diversité. Un vrai travelling de film situationniste :
Je longe l’école Paul-Éluard et aperçois, sur le trottoir, une marée d’élèves, tous noirs, d’origine africaine. Parmi eux, une silhouette attire mon regard : une jeune fille au téléphone. Sa chevelure claire me fait penser qu’elle est blanche, mais je n’en suis pas certain.
Je poursuis ma promenade et remarque deux garçons blancs, cartables sur le dos, marchant devant moi. Ils se dirigent vers deux filles noires qui les attendent sur le trottoir, discutant avec animation de « bisous ». Je me demande si ces deux petits blancs ressentent une quelconque crainte face à leurs camarades, mais leur rire en apercevant un oiseau mort sur la route dissipe mes doutes. Sans un mot de plus, le groupe reprend son chemin dans la même direction.
Nous débouchons sur la place de la République. Devant moi, ces quatre enfants avancent en discutant. Sur ma droite, un groupe de blancs, l’air de punks à chiens, boit des bières et fument des roulées. L’impression me traverse que ce quartier est désormais presque entièrement africain, à l’exception de ces quelques marginaux. Mais cette idée est aussitôt balayée par l’apparition d’une femme – la mère de l’un des deux garçons blancs. Jeune, trentenaire, elle a tout d’une bourgeoise ou d’une bobo. Elle embrasse les enfants avec affection et les accueille chaleureusement. C’est alors que je vois plein de bobos comme elle.
Zoom arrière sur l’ensemble de la place de la République.
Cette place est « végétalisée » et me fait penser à la diversité réussie de la France contemporaine. Mon regard s’élargit sur la place et je réalise la variété des visages qui la peuplent : blancs, noirs, arabes, tous se mêlent. La foule est dense. Un homme noir fait des tractions sur une barre de musculation, d’autres flânent çà et là, des familles blanches se promènent, et surtout, je vois des interactions plus nombreuses que jamais entre des personnes d’origines sociales et ethniques différentes.
Le soleil rasant baigne la place d’une lumière dorée. C’est la golden hour, ce moment où tout semble plus beau, plus harmonieux. Cette place, surpeuplée mais paisible, me donne l’image saisissante d’une France qui va bien. Je souris avant de quitter cette place tellement je me croirais dans un film de Mike Leigh.
Ce n’est ni la “créolisation” fantasmée par certains, ni le “grand remplacement” redouté par d’autres. C’est simplement Montreuil, une ville d’immigration depuis trente ans, qui se gentrifie à sa manière.
Ce qui est fascinant, c’est que ces quartiers populaires, parce qu’ils sont longtemps restés moins chers, ont d’abord attiré des artistes, des marginaux, des précaires, comme mon copain Mathieu. Puis, au fil du temps, ils ont vu arriver d’autres populations : des classes moyennes, des familles aisées mais qui ne pouvaient plus se loger à Paris. Résultat ? Une ambiance presque caricaturale d’une France agréable, écologique, tolérante. Une France où les débats politiques sur l’identité semblent inutiles, remplacés par la simple cohabitation du quotidien.
Ceux qui pensent que les immigrés venus d’Afrique veulent « islamiser » la France et nous coloniser, devraient faire un stage d’observation à Montreuil.