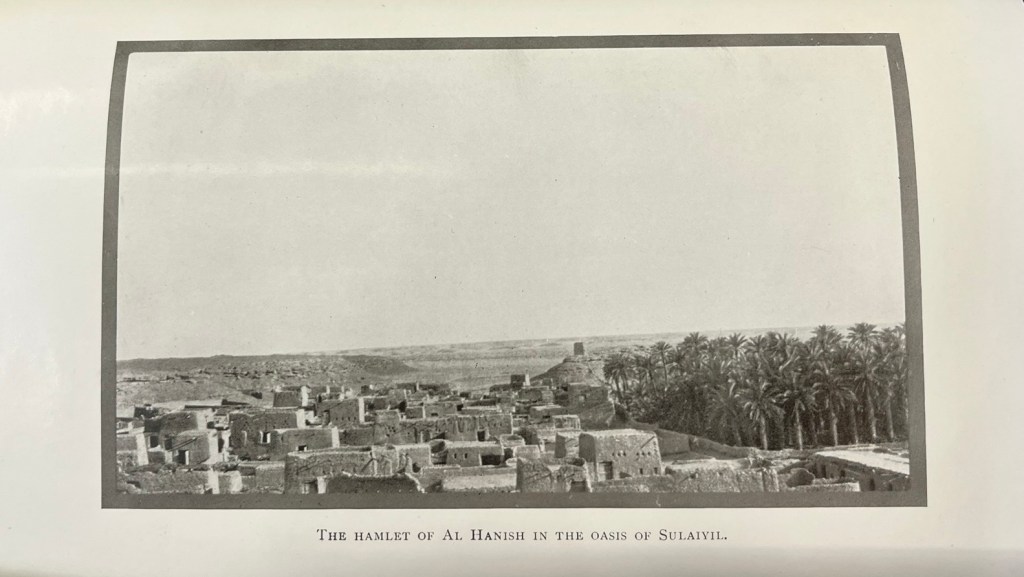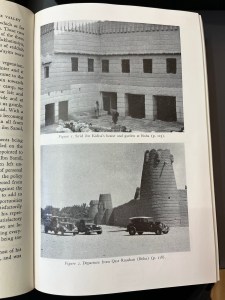Depuis vingt ans que je tiens un blog, j’ai eu l’occasion d’écrire des textes critiques et des billets d’admiration. Et s’il y a une chose qui me fascine encore aujourd’hui, c’est la différence de réception entre les uns et les autres. Les billets les plus critiques, ceux où je démonte une œuvre ou une figure publique, provoquent du remous, suscitent la discussion, parfois des contre-feux violents. Mais lorsqu’au contraire, je m’efforce d’écrire un texte élogieux, la réaction est souvent bien plus étrange.

L’éloge est un exercice rare. Toi-même, lecteur, as-tu déjà fait l’éloge de quelqu’un ? D’une certaine manière, cet exercice demande autant de courage que la critique. Oser dire du bien de quelqu’un – et pas seulement en lançant un « il est génial, elle est formidable », mais en construisant un véritable portrait, en cherchant à traduire en mots la valeur d’un travail, d’une œuvre ou d’une personnalité – est une entreprise délicate. Nous vivons dans un monde où l’on admet difficilement les jugements détaillés sur des personnes, qu’ils soient négatifs ou positifs, alors que la critique est encouragée quand elle concerne un plat, un hôtel ou un film. La norme sociale nous pousse à une certaine réserve, une pudeur des opinions. Critiquer avec force choque, mais louer avec sincérité déstabilise aussi.
Car, et c’est là ce qui me frappe le plus, les bénéficiaires de l’éloge ne perçoivent souvent pas l’effort qu’il représente. Ils le prennent pour un acquis, comme si c’était une simple constatation de la réalité, et non le fruit d’une attention, d’une écriture, d’une mise en valeur patiente. J’en ai eu l’expérience plusieurs fois.
Je me souviens d’un blogueur qui était aussi écrivain. J’avais écrit un billet élogieux sur son travail, sur sa démarche de venir dans le monde des blogs. À la suite de cela, il avait mis en lien quelques blogs amis, et avait omis le mien. Puis, un ou deux ans plus tard, il m’écrit : « J’ai changé d’adresse électronique, mon blog ne correspond plus à celui que tu as mis en lien sur ton blog, peux-tu faire le changement pour mettre à jour ? » Je vais voir son blog, et je constate que le mien n’y figure toujours pas. Mon travail ne valait donc pas la peine d’être mentionné ? Probablement pas par mépris frontal, mais par une forme de modestie perverse : ne pas afficher ce qui est trop élogieux de peur que cela ne semble complaisant. J’ai entendu cela plusieurs fois. « C’est tellement élogieux que je ne peux pas en faire la publicité. » Pourquoi pas ? Mais ce qui me surprend, ce n’est pas tant l’absence de publicité – je n’en ai pas besoin, je ne gagne pas d’argent sur mon blog – c’est l’étrange réaction psychologique qui suit. Non seulement ces personnes ne voient pas l’effort de l’éloge, mais elles considèrent en plus que je leur suis redevable.
Celui qui me demande de mettre à jour son lien, par exemple. Il ne lui vient pas à l’idée qu’il pourrait faire un effort symétrique. Le travail d’écriture que je fais vaut largement celui de ceux dont je parle. Mais non, il attend que j’accomplisse ce service, sans contrepartie, sans même envisager que le respect puisse fonctionner dans les deux sens.
Quand il s’est permis d’insister pour que je mette à jour l’adresse de son blog sur le mien, je lui ai répondu : « Tu as raison, ton blog a changé d’adresse, j’y suis allé pour vérifier. Et d’ailleurs, je te le dis en passant, je n’y ai pas vu mon blog dans ta liste d’adresses recommandées. » Je n’ai plus jamais entendu parler de lui. Il me prenait pour un panneau publicitaire.

Un autre exemple. L’autre jour, je prends contact avec un chercheur dont j’admire un livre. Je lui propose un travail d’écriture rémunéré. En réponse, il ne me dit pas non, il ne me dit pas qu’il n’a pas le temps ou que cela ne l’intéresse pas. Il me répond qu’il préférerait carrément être employé comme consultant dans l’institution qui m’emploie. Ce qui n’a rien à voir avec ma demande. À mes yeux, c’était même un manque de respect. Comment peut-on répondre ainsi ? Ai-je jamais prétendu avoir un poste à offrir ? Ce chercheur a bêtement déduit de mes témoignages construits d’admiration sincère que j’étais disposé à me mettre en quatre pour satisfaire des exigences qui n’avaient aucun rapport avec ce qui unissait nos deux esprits.
Je ne vais pas multiplier les exemples mais ils sont nombreux et, en vingt ans de blog, ils ont pris toutes sortes de formes.
J’en viens à penser que certaines personnes ont moins de respect pour moi depuis que j’ai fait leur éloge. Comme si, au lieu de créer une complicité, un lien de fraternité, l’éloge me plaçait dans une position d’infériorité. Comme si admirer le travail d’un autre faisait de moi un serviteur, alors qu’à mes yeux, c’est tout le contraire : admirer un vivant non célébré par les médias est un signe d’intelligence et d’autonomie de la pensée. Exprimer cette admiration, la mettre en forme dans un texte est le fruit d’un savoir-faire rare.
Lire aussi : Qu’être impressionné est la contraire d’admirer.
Il y a là quelque chose d’assez profond, qui touche aux lois implicites de la sociabilité. On accepte qu’un mort soit loué, comme chez Chateaubriand quand il parle de Napoléon, ou Lamartine et sa galerie de portraits des Girondins, car cela ne change plus rien et peut renvoyer à un exercice scolaire. Le meilleur de tous est peut-être Saint-Simon qui, dans ses Mémoires, fait revivre de manière baroque les personnages hauts en couleurs de la cour de Louis XIII. (Je me suis souvent inspiré de Saint Simon dans mes tombeaux et mes chroniques). Mais faire le portrait d’un vivant, et pire encore, d’un vivant qui n’est pas célèbre, semble briser un tabou. Comme si cela créait un déséquilibre, une mise en lumière inattendue qui faisait péter les plombs à la personne concernée.
L’éloge, je conclurai ainsi, bien loin d’être une soumission, est un geste de souveraineté. Si vous recevez une parole admirative de la part d’un pauvre mortel, comprenez bien que vous vous trouvez en présence d’un esprit fort et rebelle, pas d’une groupie prête à vous servir.