Au lycée français de Mascate, le brillant professeur de lettres qui officie en classes de collège et de lycée est un spécialiste de l’écrivain égyptien Albert Cossery. Il a terminé sa thèse de doctorat il y a quelques années et ne sait s’il va sacrifier encore du temps et de l’énergie à publier cette dernière, ou sacrifier aux passions paresseuses de son écrivain favori et tout abandonner à l’autel de la plage.
Cyril (c’est son nom), que j’avais dû harceler en 2016 pour qu’il participe à mon colloque sur la littérature des voyages en Arabie, est un faux fainéant dans une vallée fertile. Il a organisé en 2018 un projet de longue haleine avec ses étudiants et des collègues du lycée, sur les questions du portrait et du voyage. Un volet de ce projet pédagogique prévoyait une rencontre avec des « écrivains voyageurs ».
J’étais donc invité en compagnie de deux auteurs que j’aime beaucoup : Nicolas Presl qui crée des bande dessinée sans parole (des romans graphiques, dit-on aujourd’hui), et Antonin Potoski qu’on ne présente plus aux lecteurs de ce blog. Auteur notamment de Nager sur la frontière (Gallimard), de Cités en abîmes (Gallimard) et de L’Hôtel de l’amitié (POL), Antonin Potoski écrit des récits de voyage résolument contemporains, qui ressemblent enfin à la façon de voyager des années 2010-2020. Il est aux antipodes de ces « nouveaux explorateurs » qui veulent nous faire croire qu’ils voyagent comme au XIXe siècle et qui cherchent à écrire comme on le faisait dans les années 1930 (oui, je pense notamment à Sylvain Tesson). Potoski prend en compte ce qui se passe vraiment dans la vie quotidienne des gens qui vivent dans les pays traversés. D’ailleurs ils ne les traversent pas, il y vit. Il vit en transit et passe de points de chute en logements provisoires.
Fin mars 2018, nous fûmes réunis au Lycée français de Mascate pour une soirée littéraire très bien préparée par les élèves, leurs professeurs et d’autres membres du personnel. Les questions fusaient, posées par des étudiants différents à l’un de nous trois. Nous fûmes aussi invités à raconter notre vie en quelques mots, à commenter une image que nous avions choisie, ainsi qu’à lire quelques lignes sur le voyage. Moi, j’ai fait le cabot, car c’est à peu près tout ce que je sais faire quand j’ai un microphone. Mon épouse était là, au premier rang du public, elle rayonnait d’une beauté sombre et je voulais l’impressionner en faisant rire le public composé essentiellement d’élèves du lycée et de parents d’élèves.
Étaient présentes aussi les huiles de la francophonie et de la diplomatie française en Oman, dont l’Ambassadeur lui-même qui avait pris ses fonctions quelques semaines auparavant et qui voyait là l’occasion de rencontrer quelques-uns de ses administrés.
Je lus des extraits d’œuvres de Potoski, pour bien souligner que c’était un grand écrivain, et non juste un ami de la famille. Je fis enfin des commentaires drolatiques et impertinents sur les livres de voyage rassemblés pour l’occasion par la bibliothécaire du lycée. Ce fut l’occasion de brandir Ormuz de Jean Rolin et de clamer une nouvelle fois que si Potoski était un très bon écrivain, Rolin était carrément le meilleur parmi les vivants.
L’ensemble de nos interventions fut un succès culturel et éducatif couronné par un dîner dans un hôtel très charmant de ce nouveau quartier de Mascate, ainsi que d’une nuit avec ma femme passée dans ce même hôtel, offerte par les sponsors pour défraiement.
L’ambassadeur vint nous serrer la main à la fin de notre performance : « J’écris moi aussi, me dit-il. Je vais faire paraître un polar dans quelques jours. » Intéressant. Je me promis intérieurement de lire son livre, même si le genre littéraire adopté par l’ambassadeur n’était pas ma tasse de thé. Il revint vers le livre de Jean Rolin, qu’il prit à son tour à la main : « C’est amusant que vous ayez parlé de Rolin ; dans quelques jours, j’accueille son frère, Olivier, qui vient passer une semaine en Oman. »
Quelques semaines plus tard, des journaux locaux faisaient paraître des articles couvrant l’événement : l’un d’eux nous présentait comme trois écrivains célèbres : https://timesofoman.com/article/famous-french-authors-find-oman-experience-inspiring
Un autre article fut signé par le chroniqueur iconique néo-zélandais Ray Petersen qui, de son côté, rendait compte de cet événement dans l’Oman Observer en termes élogieux, amoureux qu’il est de la littérature française : https://www.omanobserver.om/french-literature-takes-centre-stage/

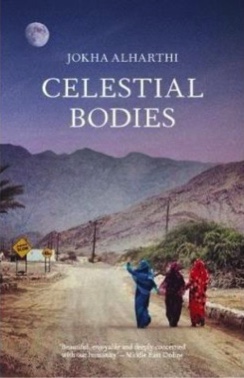




 J’ai ôté mes chaussures et ai trempé mes pieds dans l’eau tiède et rapide en regardant l’oasis de ce nouveau point de vue.
J’ai ôté mes chaussures et ai trempé mes pieds dans l’eau tiède et rapide en regardant l’oasis de ce nouveau point de vue.






















