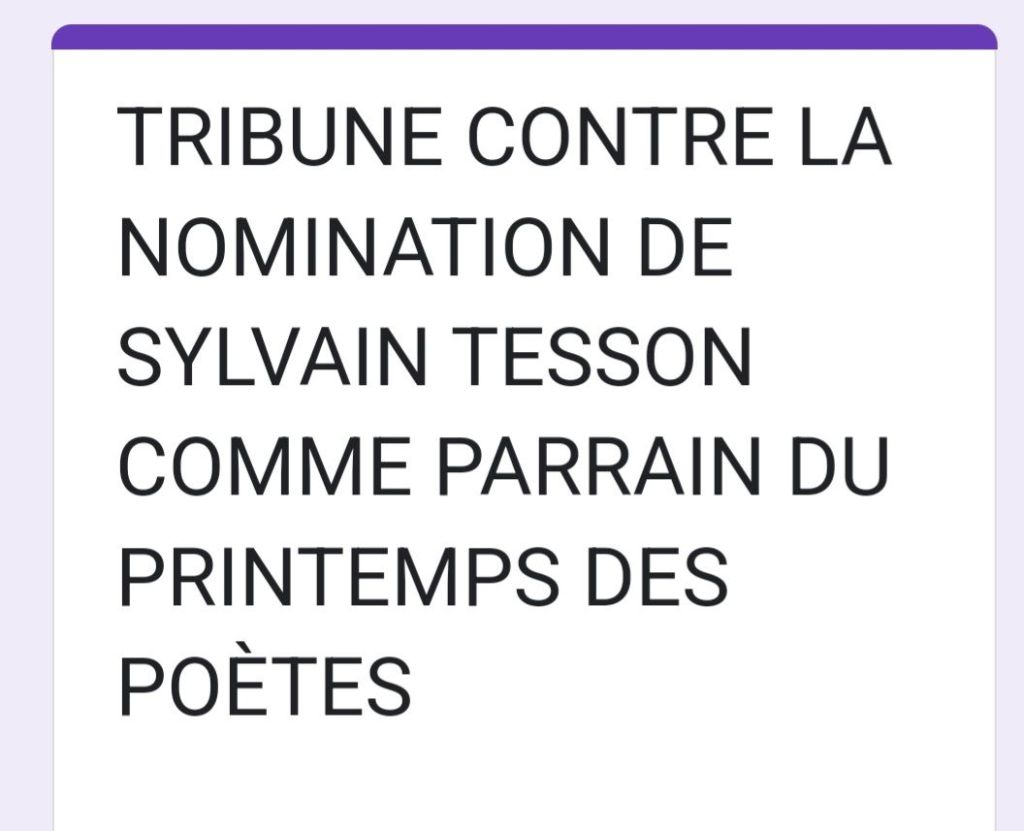J’appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l’Algérie, à l’islam.
Houria Bouteldja, Les Blancs, les Juifs et nous, p. 72
Chaque mot de cette phrase fait mal. L’autrice sait ce qu’elle fait et elle sait ce qu’elle risque. On la traitera de raciste, de communautariste, on lui dira de rentrer en Algérie si elle n’aime pas la France, etc.
Dans ce chapitre, intitulé « Nous, les Femmes indigènes », elle conduit une brève réflexion sur le féminisme en contexte immigré, post-colonial et islamique. Ne peut-elle pas voir dans le féminisme proposé autre chose qu’un phénomène « blanc », pour « femmes blanches » ?
En même temps, comme dans l’ensemble de l’essai, Houria Bouteldja crie quelque chose d’intime qui me bouleverse. Ses mots me touchent notamment parce que la femme que j’aime est elle aussi arabe, musulmane, intellectuelle, émancipée, et inextricablement liée à sa famille.
Je n’ai rien à cacher de ce qui se passe chez nous. Du meilleur au plus pourri. Dans cette cicatrice, il y a toutes mes impasses de femme.
Idem.
Je trouve qu’il y a une immense générosité à oser parler des « impasses de femme » à un lectorat ouvert, possiblement hostile. C’est la preuve que son livre n’est pas une déclaration de guerre, ni un rejet unilatéral de la France, mais une tentative fière et émue de nous tendre la main. On peut essayer de se comprendre.
Le monde est cruel envers nous. L’honneur de la famille repose sur la moustache de mon défunt père que j’aime et que la France a écrasé. (…) Mon frère a honte de son père. Mon père a honte de son fils. Aucun des deux n’est debout. Je ramasse leur virilité déchue, leur dignité bafouée, leur exil.
Idem.
Le féminisme que Bouteldja va tenter de mettre en place ne peut pas s’adosser à un individualisme de type Lumières/Révolution française. Selon elle, la trahison que serait l’émancipation individuelle conduirait obligatoirement à « imiter » les Blanches, et à tout perdre en bout de course.
C’est pourquoi elle parle de ce réseau complexe de relations amoureuses entre hommes blancs, femmes indigènes et hommes indigènes. Ça fait mal de voir les choses sous cet angle de la possession des femmes, ça fait mal à notre bonne conscience de républicains universalistes, mais c’est toujours un peu comme ça que les choses sont vécues dans les communautés qui se sentent menacées : vous ne prendrez pas nos femmes, ou alors, il faudra payer.
Pourquoi croyez-vous que les Travellers irlandais sont encouragés à se marier dès l’adolescence et à faire beaucoup d’enfants ? Pour empêcher que les « paysans », les Irlandais majoritaires, ne séduisent leurs filles.
Et pourquoi croyez-vous qu’Éric Zemmour finit son livre sur la féminisation de la France en fantasmant sur les filles blanches qui se jettent dans les bras des arabes et des noirs, déçues qu’elles sont par le manque de virilité des petits blancs ? Zemmour et après lui tous les masculinistes d’internet disent que la virilité est aujourd’hui incarnée par les bad boys des quartiers, donc les frères d’Houria Bouteldja.
Tandis que les immigrés sont toujours renvoyés à leurs origines et traités comme des ennemis de l’intérieur en passe de « remplacer » et « conquérir » l’Europe des doux chrétiens blancs, les identitaires voient la France comme un pays « soumis » aux pays africains (!), peuplé d’une masse historique qui n’a plus de vigueur. Chez les masculinistes, en général, on note cette crise de masculinité et cette peur panique de tout ce qui est femme, homo, noir, arabe et musulman. Cela explique pourquoi la plupart du temps, les masculinistes se fondent dans l’extrême-droite et le racisme. Leur sentiment de défaillance sexuelle les fait rêver à des leaders politiques « forts », « fermes », à poigne, c’est-à-dire crypto-fascistes.
Houria Bouteldja, elle, nous invite à un autre chemin, moins délétère. Celui de se libérer de tous ces jeux de rôles qui nous emprisonnent dans des « imitations » de stéréotypes : ces « beurettes » qui imitent les blanches, ces djihadistes qui imitent les armées coloniales, ces noirs qui portent des masques blancs, ces hommes qui maltraitent leur femme pour imiter les chefs et les flics.
Si nous avons une mission, ce serait de détruire l’imitation. Ce sera un travail d’orfèvre. Il faudra deviner dans la virilité testostéronée du mâle indigène la part qui résiste à la domination blanche, la canaliser, en neutraliser la violence contre nous pour l’orienter vers un projet de libération commun.
Nous, les Femmes indigènes, p. 96-97.
Alors moi, quand on me demande si je suis fier d’être français, je dirais que je peux l’être dans la mesure où la culture française a su produire des intellectuels comme Houria Bouteldja, qui s’exprime d’une manière qu’on ne retrouve dans aucune autre langue. Et la France n’est jamais plus belle que lorsque ses hommes font silence quelques minutes pour écouter ses « femmes indigènes ».