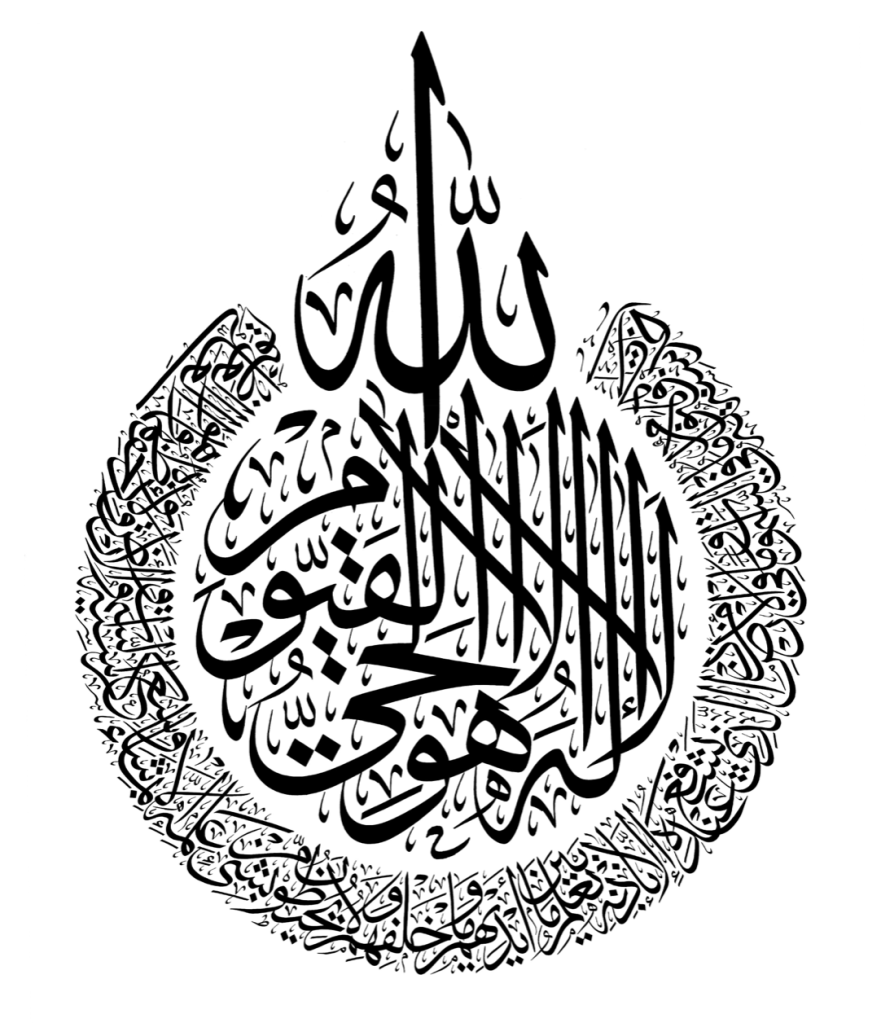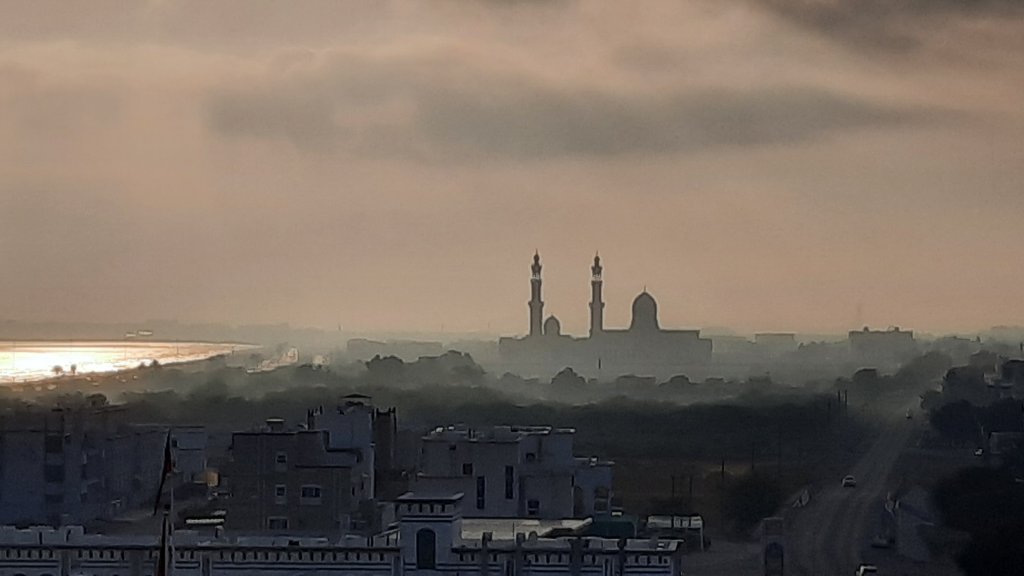Au départ, je n’avais rien demandé, rien. J’étais juste un petit enseignant chercheur qui se satisfaisait de travailler avec ses étudiants et de faire des recherches sur la littérature de voyage. J’avais trouvé mon point d’équilibre dans une carrière précaire.
Un jour, dans le bureau que je partageais avec un collègue, je reçois un coup de fil d’une secrétaire qui me dit que le doyen nouvellement nommé à la tête de la faculté veut me voir. « Qu’est-ce que j’ai fait comme connerie encore ? » Ce fut ma réaction, comme à chaque fois qu’un supérieur hiérarchique me convoque.
Dans le bureau du doyen, je vois un homme de petite taille au regard très pétillant d’intelligence et à la coupe de cheveux de ceux qui passent une mèche sur leur crâne dégarni. Moustachu, le doyen me serre la main doucement, à l’arabe, d’une main baguée qui ne manque pas de raffinement. Il s’excuse de m’avoir dérangé et se justifie en disant qu’il voulait rencontrer le personnel enseignant pour se faire une idée de ce qui se passait dans ce college.
Il me dit qu’il a entendu parler de moi du fait de la parution d’un livre aux éditions de l’Université Paris-Sorbonne. C’est vrai, dis-je, je peux vous en offrir un exemplaire… Non cela ne l’intéresse pas car il ne lit pas le français. En revanche il me pose des questions pour en savoir davantage sur mes recherches. Je suis enchanté de cette conversation car depuis deux ans que je travaille à l’université de Nizwa, personne n’avait vraiment pris la recherche au sérieux au sein du département des langues étrangères. Lui-même se situait, dans l’organigramme, bien au-dessus de mon département : la faculté qu’il dirige comprend cinq départements de sciences et de lettres parmi lesquels celui des langues. Le College of Arts and Sciences est de loin la plus grosse faculté de l’institution, et pour ainsi dire une université dans l’université.
J’étais donc flatté que le doyen s’intéresse à moi et ne savais pas qu’il était en fait à la recherche de la bonne personne pour occuper le poste vacant de vice-doyen à la recherche et aux études supérieures. En ce qui me concerne, je n’avais aucune idée de ce qui se passait au-delà des unités qui m’étaient les plus proches : sections de langues et département des langues étrangères. Si on m’avait demandé de diriger une unité à ce niveau de compétence, j’aurais su à peu près que faire et je serais parti avec des idées relativement assurées pour améliorer la situation. Par contre, les unités de direction supérieure m’étaient inconnues et le monde des doyens, des chanceliers et vice-chanceliers m’étaient tout aussi mystérieux que le sont les conclaves de l’église orthodoxe. Or, pour revenir à ma conversation avec le doyen, je lui confiais que, à mon avis, l’élaboration du savoir, les publications et les conférences n’étaient pas une priorité dans certains départements.
En réalité, les choses étaient pires que cela : j’avais essayé de créer avec quelques autres une ambiance de recherche en organisant des journées d’études, en participant à des colloques internationaux et en proposant des ateliers de formation mais cela m’avait valu des inimitiés. Certaines personnes s’étaient senties menacées dans leur confort et leurs privilèges et ne voulaient surtout pas que la recherche apparaisse comme un devoir. Cela devait rester quelque chose de facultatif, bienvenu certes, mais cantonné à une position subalterne et quasiment décorative. J’avais donc été remisé dans une sorte de placard symbolique. Le nouveau doyen semblait avoir envie de m’en sortir. Il se proposait de m’aider.
Quand je sortis de son bureau, je croisai un de mes rares collègues qui publiaient des articles dans des revues universitaires. Il avait rendez-vous lui aussi avec le doyen, et lui non plus ne savait pas ce qu’il avait fait comme connerie.
Le lendemain, tous les membres de l’université recevaient un courriel du chancelier avec une pièce-jointe écrite en arabe. C’était une résolution officielle qui me nommait vice-doyen chargé de la recherche et des études supérieures (Assistant Dean for Graduate Studies and Research) pour le compte de la faculté des lettres et des sciences (College of Arts and Sciences). Ma femme poussa un cri de joie car elle était la seule personne qui me voyait à ce poste depuis des mois. Elle m’avait déjà dit, en passant devant le bureau vide du vice-doyen, que ce bureau devrait m’échoir à moi et à personne d’autre. De mon côté je ne me souviens pas de ce que je ressentis mais je sais ce que j’ai pensé, rationnellement : c’est une erreur de casting.
Immédiatement, des personnes que je connaissais de loin venaient me féliciter et me dire que c’était un peu grâce à eux que l’on devait cette nomination. L’un d’eux me prit à part : maintenant fais attention à toi dit-il. Les envieux et les jaloux vont très vite se manifester et beaucoup de gens vont essayer de te faite échouer. Fais ton travail tranquillement, ne t’inquiète pas si ça tangue un peu, parce que ça va tanguer.