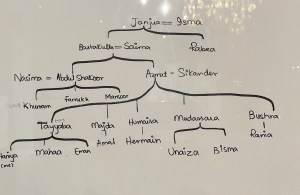Après avoir été très enthousiaste pour le premier livre d’Édouard Louis, Pour en finir avec Eddy Bellegueule, publié en 2014, je lis avec plaisir mais un soupçon de déception le bon livre de 2024, Monique s’évade.
Ce texte raconte, toujours avec la même méthode puisée chez Annie Ernaux, l’évasion, en effet, de la maman du narrateur, qui avait déjà réussi à quitter son mari et qui vivait avec un nouvel homme qui la maltraitait.
Édouard Louis met en scène une coopération, une alliance entre mère et fils pour organiser la fuite, et même une relation tripartite mère-fille et fils, puisque la sœur apparaît dans le protocole. Ils inventent de nouvelles relations qui ne soient plus simplement filiales et familiales. Ils tâchent, tous les trois, de créer une forme d’amitié d’adultes, comme je le fais moi-même avec ma propre mère
Les Plaisirs de ma mère
La Précarité du sage, 2014
Le texte de Louis est très intéressant mais littérairement, c’est, franchement, un ton en dessous que celui qu’il a publié en 2014. Il faut le dire, mais il ne s’agit pas de critiquer de manière brutale et légère. C’est difficile, l’art de narrer. On voit dans ce livre combien c’est délicat, la littérature. C’est délicat parce que c’est de l’art.
Il y a de nombreuses pages moins puissantes, non pas que Louis manque d’inspiration (il est inspiré, il a du talent), mais son phrasé touche moins au but. Peut-être parce que cela correspond déjà à une recette élaborée par quelqu’un d’autre. Louis accumule les formules qui sont censées frapper au cœur du sujet mais qui se révèlent poussives :
Et je pensais : Arrête de réfléchir ! Il faut agir d’abord, réfléchir après.
Sans ça il n’y aurait jamais d’évasion.
Nulle part.
p. 68.
Par endroits l’auteur essaie plusieurs formules, il s’y reprend à plusieurs reprises, insatisfait et pourtant incapable de tout effacer pour recommencer et trouver le paragraphe qui sonne juste. Je cite trois phrases apparaissant telles quelles dans le livre, dans cet ordre et cette succession :
Je n’avais jamais vu mon père accomplir la moindre de ces tâches en quinze ans.
Elle n’avait jamais fait quoi que ce soit pour elle-même.
Sa vie avait été, jusqu’à maintenant, une vie pour les autres.
p. 34-35.
Cela est bien vrai et peut mériter d’être dit, mais on pourrait continuer ainsi sur des pages car cela demeure malgré tout une sorte de cliché.
J’avais dit, dans mon billet consacré à son premier livre, que le travail génial était celui d’Annie Ernaux parce qu’elle inventait un genre. Personne n’avait vraiment écrit de cette manière-là sur son père, sa famille, et sur la distance qui apparaît avec sa famille quand on grandit, quand on fait des études.
Personne n’avait vraiment dit, de manière très plate et sensible, de manière factuelle et artistique, la rupture dans le langage même, dans les codes, la manière dont les codes et la façon de parler s’inscrivent dans le social. Donc elle, Annie Ernaux, tâtonnait, elle cherchait son style, elle cherchait sa voix.
Édouard Louis, au contraire, partait avec cette capacité d’analyse, mais surtout il avait acquis chez Annie Ernaux le genre littéraire qui était le sien.
Et là, il y a beaucoup de phrases qui sont un peu banales, qui n’ont pas la dimension de surprise, de révélation, que l’on trouve dans les livres réussis.
Et dans ce type de littérature-là, la littérature à la fois factuelle, sociale et personnelle, on s’en rend bien compte aussi quand on lit Didier Eribon lui-même, qui apparaît dans Monique s’évade comme l’ami du narrateur qui peut assister la maman en fuite. Ce type d’écriture peut vite s’avérer banale car elle s’ingénie à parler de choses quotidiennes, apparaissant comme naturelles aux protagonistes. Elle réclame donc beaucoup de travail pour distinguer les notations de micro-événements significatifs et les remarques sans intérêt.
C’est quand même un livre réussi : je vais vous donner un exemple de moments où Monique S’évade, le livre, a quelque chose de fort, d’original, de singulier.
Pendant ces quelques jours de fuite et de préparation de sa Nouvelle Vie, ma mère réclamait une prise en charge totale. Elle estimait qu’elle avait droit au repos et à l’assistance radicale après ce qu’elle venait de vivre, et j’étais d’accord, je le faisais volontiers – Didier l’avait fait pour moi des années plus tôt
p. 42.
Cette volonté d’être entièrement prise en charge est intéressante car elle arrive de manière un peu contre-intuitive. On aime bien donner l’image inverse dans les récits de transfuge de classe : donner l’impression qu’on s’est battu, qu’on a inversé les forces du destin, les forces de l’habitude.
C’est intéressant qu’à l’intérieur de ces récits de lutte, de survie, il y ait ces moments-là où l’on dit qu’on voudrait être entièrement passif.
J’ai beaucoup aimé les détails pratiques concernant le déménagement de sa mère. Le narrateur révèle à la fois la gentillesse du fils qui veut aider et son inaptitude aux tâches simples de la vie populaire : il achète des cartons à distance (je n’ai jamais acheté un carton de ma vie car je sais où me les procurer gratuitement), il se demande combien il en faut, dix ? Vingt ? Ce mec n’a vraiment aucune idée, ça m’a fait sourire, comme son questionnement sur les rouleaux de scotch, et sa dernière question m’a carrément fait rire :
Est-ce qu’il fallait des gants pour se protéger des coupures du carton ?
p. 77.
Alors oui, Édouard, on peut porter des gants, mais pour être franc, si on travaille avec soin, on devrait pouvoir se sortir d’un petit déménagement sans coupures ni blessures.