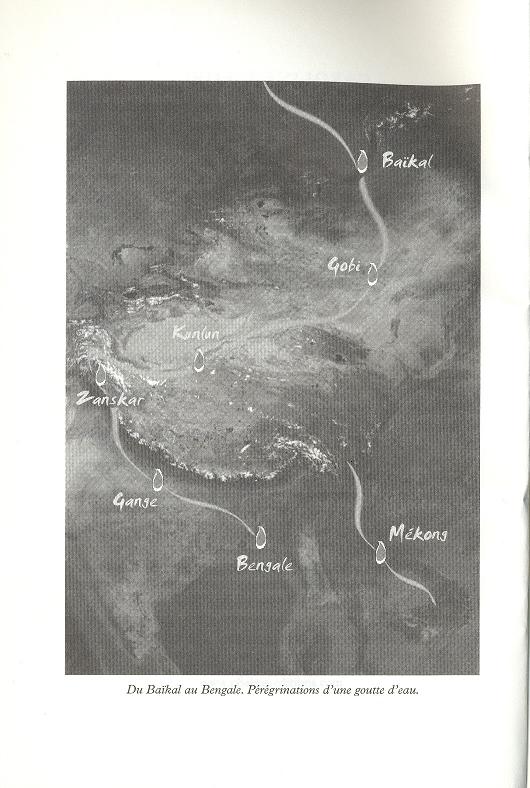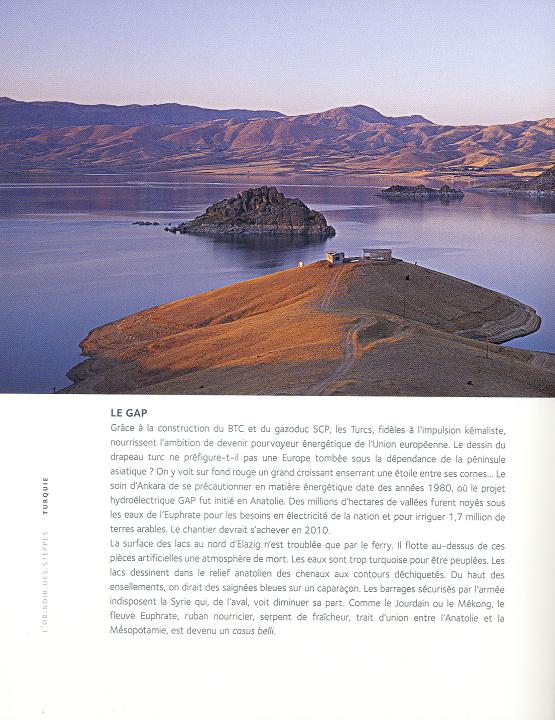Lecteur, regarde cette image d’arme à feu, surmontée de ces néons qui disent « Hors d’usage », et demande-toi à quoi cela correspond.
Pour un Français, c’est une oeuvre d’art minimaliste (ou conceptuelle, ou arte povera, etc.) telle qu’on en voit des tas dans nos musées et nos expositions internationales.
A Belfast, tout de suite, cela prend un sens plus ancré : fin des Troubles entre les groupes paramilitaires républicains (indépendantistes) et unionistes (pro-britanniques). Cela renvoie à tous les désarmements en général, mais ici, on pense d’abord au désarmement des groupes paramilitaires.
Quand j’ai demandé à des amis ce qu’ils avaient pensé de l’exposition, à ma connaissance, personne n’a aimé. Ou plutôt, personne de ma connaissance n’a aimé. Cela revient peut-être un peu au même, je ne sais pas. Ce qu’on lui reproche, à l’exposition, c’est un message trop évident, une leçon un peu trop naïve et fatiguée du genre « les catholiques et les protestants main dans la main », « aimons-nous les uns les autres », etc.
Cet aspect-là existe, c’est certain, et c’est aussi obvie que cela peut l’être.
Originaire de Glasgow en Ecosse, Buchanan est accueilli à la gallerie Ormeau Baths et présente des oeuvres qui tournent en effet toutes autour des passages entre les deux religions. La qualité de ses oeuvres, alliée à une posture politique claire, simple et aisément reconnaissable géographiquement (minorité religieuse à l’intérieur de la Grande Bretagne), le rend éminemment exportable dans le monde entier. Le soir du vernissage, il revenait de Taiwan.
Je recommande à mes amis artistes de prendre modèle sur Buchanan : un message clair et simple à la surface, pour complexifier si nécessaire dans le détail.
Voici les éléments du succès : photos d’un club de foot « irlandais » en Ecosse, mais dont les joueurs sont d’une autre religion que celle supposée, ou des joueurs d’une autre couleur de peau, combinatoire presque infinie. Deux grands portraits de l’artiste et de sa femme, à côté desquels sont exposées les origines « ethniques » de ces derniers, et des statistiques qui montrent qu’ils ont fait un « mariage mixte ». Des vidéos de fanfares protestantes et de fanfares catholiques diffusées simultanément mais séparées par un mur, et avec le son d’une seule des deux vidéos.
Etc., etc.
Ce sont les éléments du succès pour les commissaires d’exposition, bien sûr, pas pour le grand public. Le grand public, même cultivé, ne va jamais aux expositions d’art contemporain et c’est à peine s’il s’intéresse à l’art non contemporain. Il est donc logique que l’art fasse son business en dehors de lui. A la différence de la politique, si vous ne vous intéressez pas à l’art, l’art ne s’intéresse pas à vous.
J’ai beaucoup aimé une installation qui tourne autour de Thomas Muir, un Ecossais des Lumières qui a fluctué entre les religions pour devenir un révolutionnaire français, et dont le destin croise l’histoire de l’Europe, de l’Amérique et même de l’Australie. Une installation qui joue avec plusieurs médias et plusieurs dimensions de la culture, mêlant l’enfance de l’artiste, le quartier où il a grandi, avec la vie de ce personnage extraordinaire. Il y fait un usage de la chronologie qui nous mène à réfléchir sur le sens des événements historiques, sur les lectures individuelles et collectives de l’histoire.
Comprenez, mes amis ? Un message clair, quitte à complexifier après, en dessous. Un message clair pour que les Chinois, les Japonais et les Anglo-saxons puissent se dire : « Ah lui ? oui, son truc c’est … » ; « Je vous recommande Une telle pour votre biennale : son travail tourne autour de … »
Cela explique le succès de la sagesse précaire : des messages simples sur un fond compliqué. Des principes clairs, des gestes autoritaires et une expression confusément volontariste.