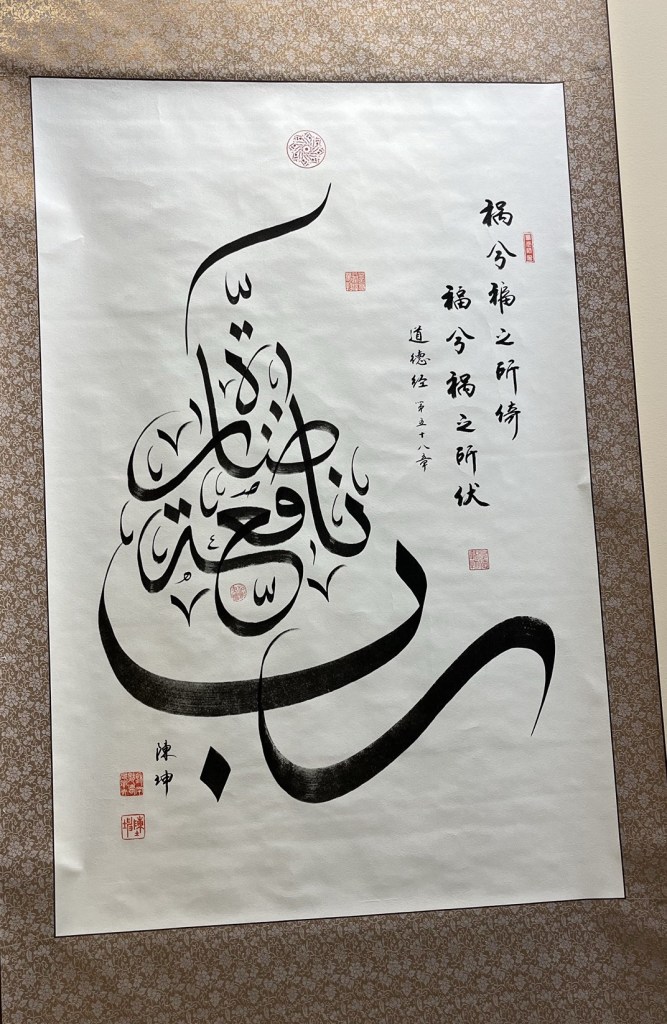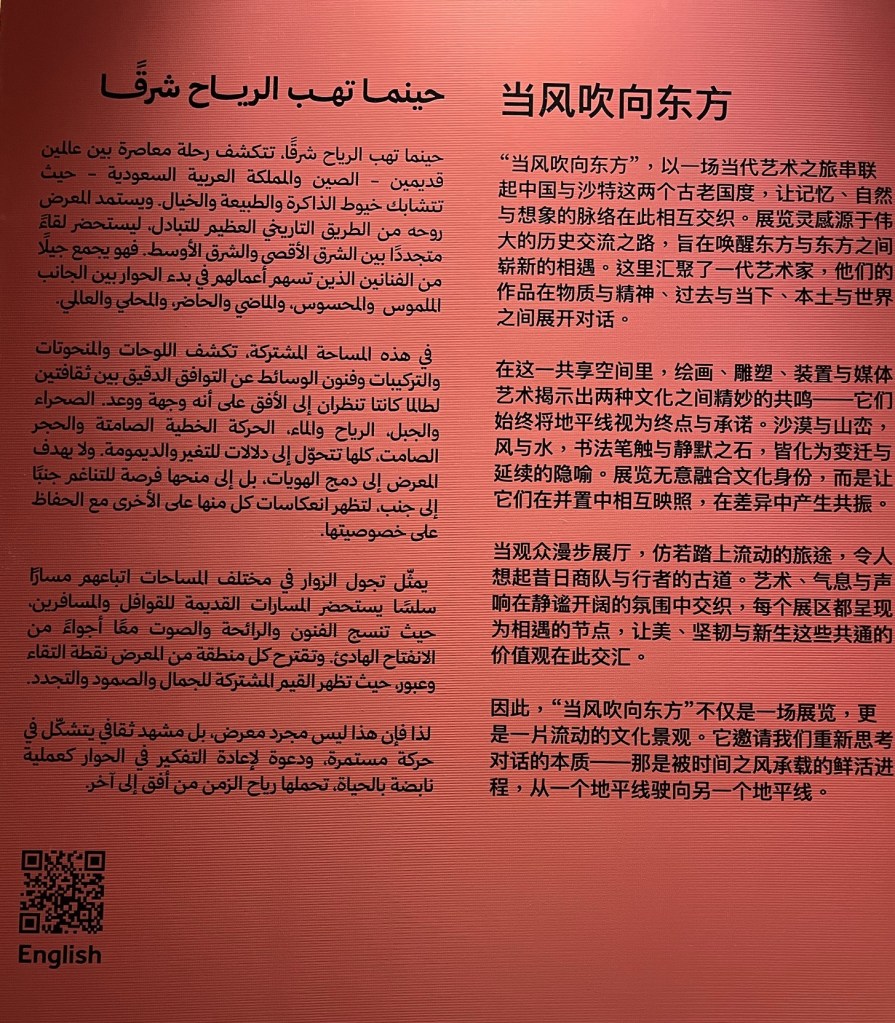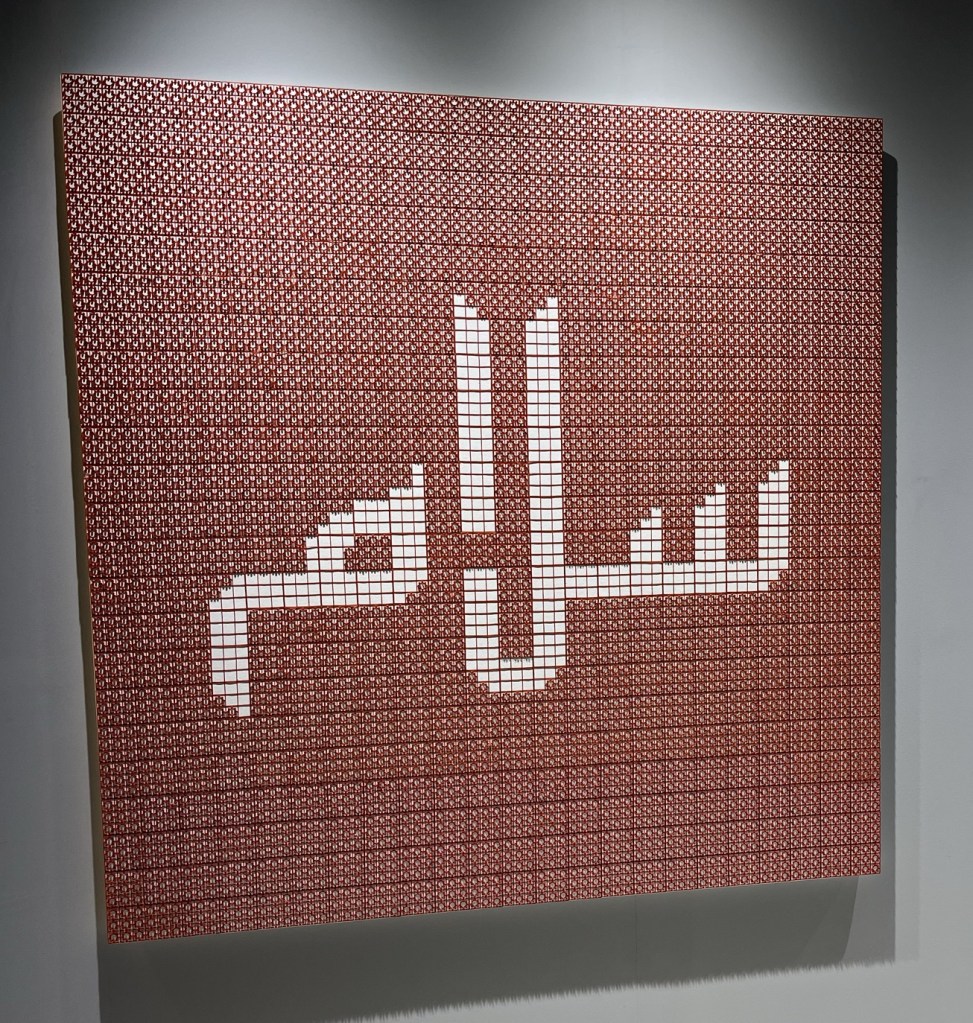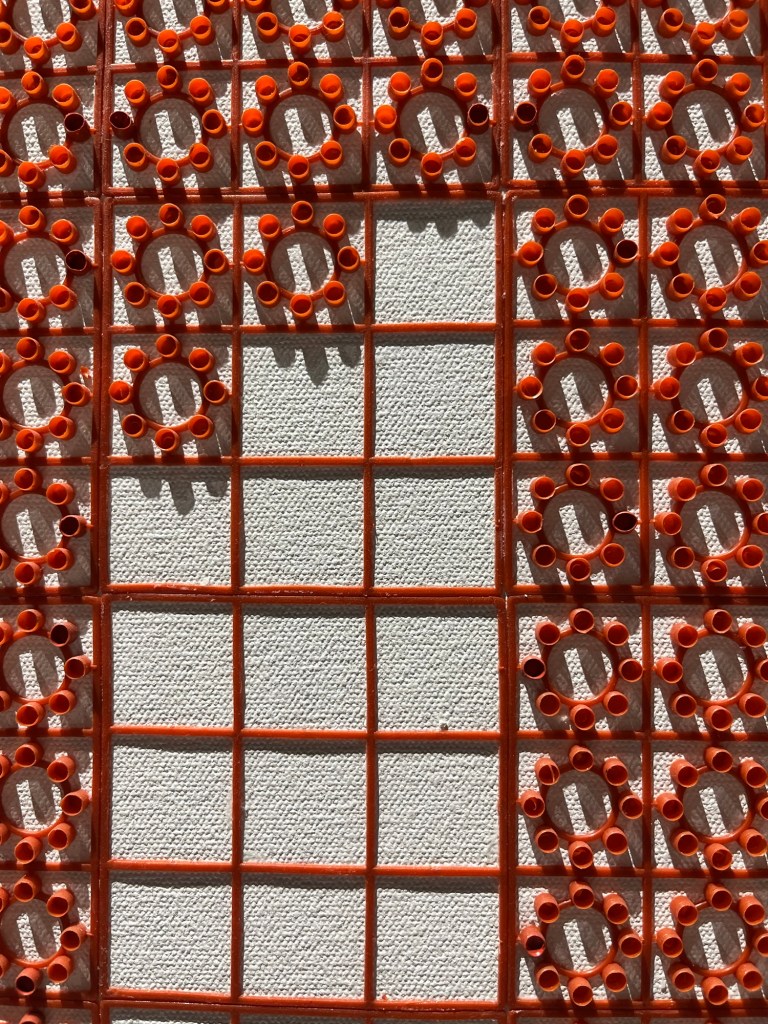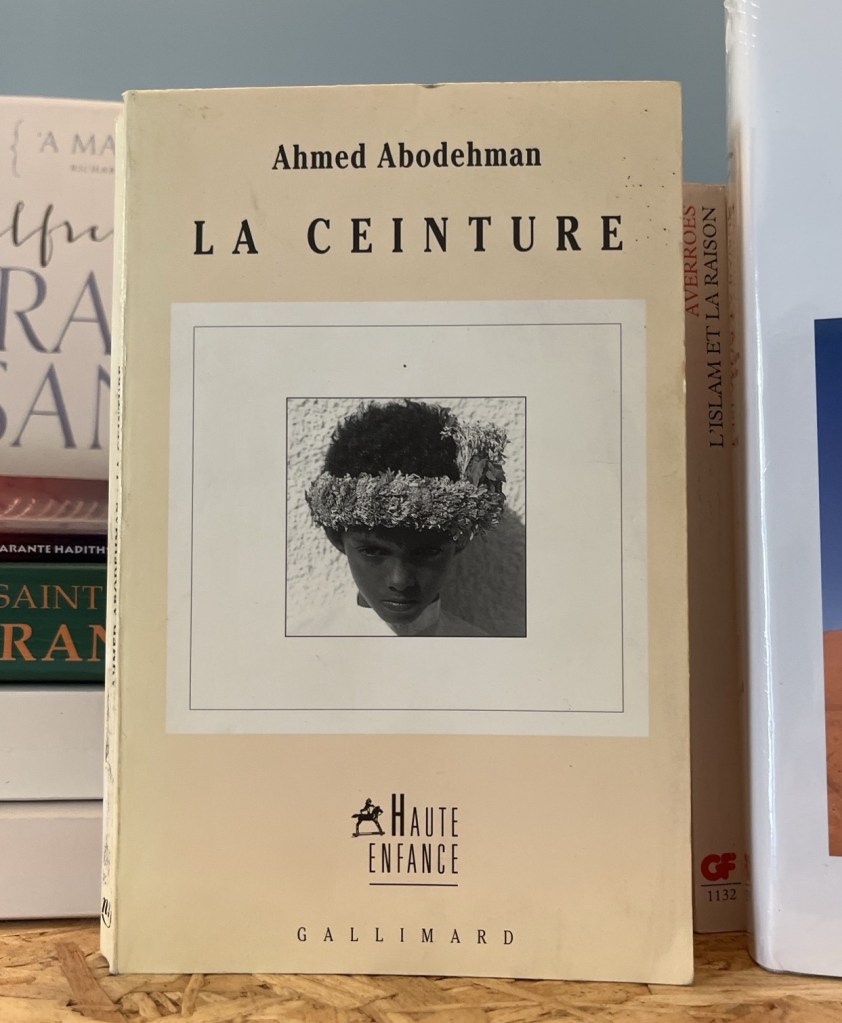Cette semaine, une information très importante est tombée dans le paysage de la télévision française. Jean-Marc Morandini a été définitivement condamné pour agression sexuelle sur mineurs. La condamnation est claire, définitive, et ne laisse aucune ambiguïté sur les faits. Et pourtant, il conserve son emploi. Il conserve ses émissions sur CNews.
Pourquoi cette histoire m’intéresse-t-elle ? Parce qu’elle fait directement écho à une histoire qui s’est déroulée à l’université de Nizwa, au Sultanat d’Oman, sur un point précis : les relations de pouvoir entre un chef et tous les autres.
Dans le cas de CNews, il est évident que la plupart des personnes qui sont payés grassement n’ont aucun intérêt à la présence de Morandini. Sa condamnation pollue l’image de la chaîne. Sa présence les rend, de fait, plus ou moins complices d’une situation moralement intenable. Tout le monde serait donc objectivement en faveur de sa disparition médiatique, ou au minimum d’une mise à l’écart discrète.
Or, une seule personne veut que Morandini reste : l’actionnaire principal Vincent Bolloré. En le maintenant à l’antenne, il montre bien sûr que le pouvoir lui appartient, ce que personne ne contestait. Mais surtout, il teste autre chose : le degré de soumission de l’ensemble de ses collaborateurs, y compris de ceux qui se présentent comme des défenseurs de la liberté d’expression, de la rectitude philosophique et de la morale chrétienne. Pascal Praud, Michel Onfray et Philippe de Villiers sont forcément très embarrassés.
Ce faisant, le milliardaire Bolloré met en danger l’équilibre de sa propre chaîne. Il affaiblit son image et celle de tous ceux qui y travaillent. Mais ce coût est secondaire. L’enjeu principal est ailleurs : vérifier que personne n’osera s’opposer à lui.
C’est exactement ce que j’ai observé à l’université de Nizwa entre 2015 et 2020. À l’époque, le chancelier de l’université, que tout le monde appelait docteur Ahmed, revenait d’une longue maladie. Il était affaibli politiquement et devait réaffirmer son autorité.
Dans le département d’anglais, une femme occupait une position de pouvoir informelle, proche de celle d’une cheffe de département. Elle harcelait les collègues, se montrait brutale et autoritaire. Sur le plan académique, elle était totalement incompétente : aucune publication, aucune capacité à élaborer une conférence ou organiser un colloque, des étudiants qui se plaignaient régulièrement de la qualité de ses cours. Ses enseignements n’étaient d’ailleurs jamais évalués de manière objective, car elle avait organisé les choses pour échapper à toute évaluation des pairs.




Sur le plan administratif, elle était tout aussi défaillante. En tant que vice-doyen du collège, j’étais son supérieur hiérarchique et en capacité d’évaluer son travail administratif. Il était clairement insuffisant. Il n’y avait donc aucune raison valable pour qu’elle reste à son poste. Tout le monde souhaitait son départ.
Tout le monde, sauf une personne : le chancelier. Pour lui, défendre cette personne indéfendable était une manière de tester son pouvoir. Il voulait voir qui allait le suivre, qui allait se taire, et qui oserait s’opposer à lui. À travers elle, il jouait sa propre autorité. Est-ce que quelqu’un allait contester et risquer un conflit frontal ? Ou est-ce que tout le monde allait s’écraser ?
Moi je me suis opposé à cette situation car j’étais naïf et croyais qu’elle gardait sa capacité de nuisance par manque d’information : je pensais bêtement que si mes chefs étaient au courant de ses actions nocives, ils prendraient les mesures qui s’imposaient. En vérité je les embêtais car ils fermaient les yeux pour ne pas contredire le sultan de l’université. Le chancelier a sauvé in extremis cette employée désastreuse qui était sur le point d’être remerciée et l’a montrée à tout le monde en silence.
Il a gagné. Tout le monde s’est écrasé. Progressivement, les discours ont changé. Cette femme est devenue, par opportunisme, une « grande travailleuse ». Certains se sont même mis à dire du bien d’elle sans qu’on le leur demande, simplement pour plaire au pouvoir.
À un moment donné, mon épouse s’est rendu compte que cette femme avait plagié sa thèse de doctorat. Elle possédait en réalité deux doctorats, sous des noms différents, avec des titres, des disciplines et des départements différents, mais avec un texte identique à environ 80 %. Il s’agissait clairement d’un plagiat, doublé d’une fraude académique destinée à obtenir des postes dans des universités plus rémunératrices que celle de son pays d’origine, notamment dans les monarchies pétrolières du Golfe persique.
C’était une violation grave de l’intégrité académique, qui aurait dû conduire à un licenciement immédiat. Mon épouse, avec quelques collègues, a alors lancé une alerte et tenté d’informer l’administration.
Comme souvent dans les affaires de lanceurs d’alerte, ce sont eux qui ont payé le prix. Elle a été harcelée, puis licenciée. Mon contrat, à moi, n’a pas été renouvelé. Il était évident qu’ils ne conserveraient pas le mari d’une lanceuse d’alerte.
Nous avons appris récemment que cette femme a non seulement été maintenue en poste, mais qu’elle a été promue, en remerciement de ses efforts lors d’un procès attenté par un de nos collègues qu’elle a humilié et harcelé. Promotion non pas en raison de ses compétences, donc, mais parce qu’elle servait toujours le même objectif : prouver la soumission totale d’un système fondé sur la peur et la corruption.
C’est ainsi que le Sultanat d’Oman et certains milliardaires bretons se retrouvent dans une même histoire. Dans le cas de Bolloré et Morandini, la condamnation judiciaire rend le mécanisme encore plus visible. Cette affaire montre, dans une forme chimiquement pure, une structure de pouvoir fondée sur la domination, la soumission et le silence.
L’anthropologie a créé un concept avec le « bouc émissaire », la sagesse précaire est sur le point d’inventer une notion inverse qui désignera la branche pourrie, le maillon faible qu’un chef conserve ostensiblement pour régénérer sa propre domination sur son groupe.