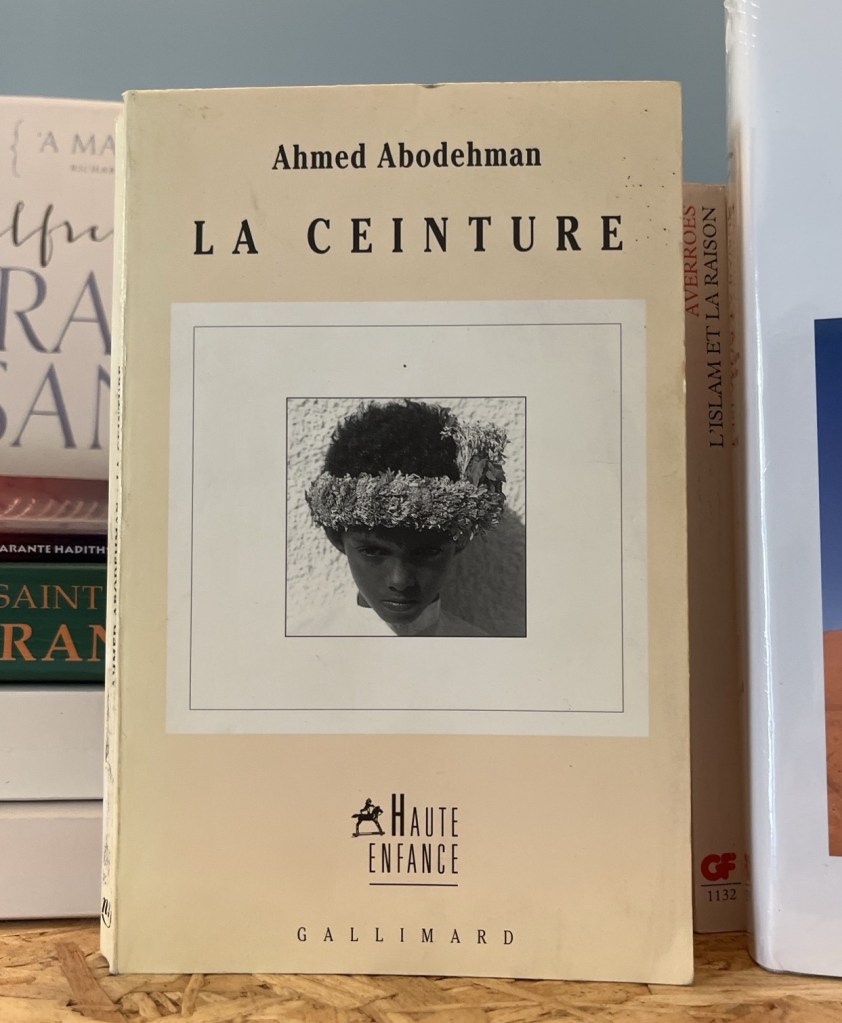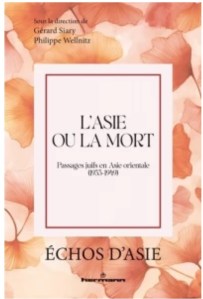Depuis près de deux décennies, Richard Malka s’est imposé comme le chantre officiel de la liberté d’expression « à la française », du droit inaliénable au blasphème et de la moquerie des religions. Mais il est temps de poser la question ce qui est sacré pour Richard Malka. Se moquer du sacré des autres nous rapproche du racisme ordinaire. Dans quelle mesure les dessinateurs et les auteurs de Charlie Hebdo se moquent de ce qui est sacré pour eux ? D’où la question de ce billet : quelle est la limite de la liberté selon Malka et surtout, quels sont les angles morts ?
L’histoire commence dans les années 1990, lorsque Malka devient l’avocat personnel de Philippe Val, alors directeur de Charlie Hebdo. Une proximité d’amitiés et d’intérêts, qui deviendra au fil du temps une alliance idéologique et un partenariat d’affaires. Quand Charlie est attaqué en justice, Malka le défend, ou plus exactement, il défend la ligne éditoriale imposée par Val, même au prix de trahisons internes. Car oui, Malka a soutenu Philippe Val contre d’autres figures historiques du journal, ces dessinateurs et chroniqueurs qui incarnaient l’esprit irrévérencieux originel de Charlie Hebdo.
Et lorsque surviennent les attentats atroces de janvier 2015, le monde entier salue les victimes, dénonce la barbarie. Malka, lui, s’empare de cette tragédie pour asseoir une autorité médiatique et morale, multipliant depuis les livres et les interventions pour affirmer un credo : tout peut, et doit, être moqué, en particulier le sacré religieux.
Mais voilà : tout le monde n’est pas égal devant cette liberté de blasphémer. Prenons Dieudonné, par exemple, que Malka n’a jamais défendu, bien au contraire. Ou encore Siné, pilier historique de Charlie, licencié pour une chronique jugée « antisémite » alors qu’elle ironisait sur la conversion du fils Sarkozy au judaïsme avant d’épouser une riche héritière, dans une tournure gentiment ironique : « Il ira loin ce petit ». Rien de plus. Et pourtant, ce fut assez pour que Philippe Val, avec le soutien juridique de Richard Malka, le licencie. Où était alors la liberté d’expression ? Où était le droit au sarcasme et la sacro-sainte satire ? Au contraire, chez les compères dirigeants du journal, l’esprit de sérieux s’imposa pour nous dire qu’il ne fallait jamais associer les juifs et l’argent, que cela nous renvoyait aux heures les plus sombres de l’histoire, etc.
Il y a donc, dans le discours de Malka, une frontière invisible mais bien gardée : on peut se moquer des musulmans, des catholiques, des prophètes de la bible et du coran, des croyants, des dogmes, mais il ne faut pas toucher aux liens entre les juifs et l’argent. Il veut bien qu’on se moque de la religion juive, d’ailleurs, des rabbins, de Moïse et du livre religieux, mais pas d’Israël en tant que projet politique et géopolitique. On le voit depuis les massacres post-7 octobre 2023, dans les prises de paroles de Val et de Malka, Israël est sacré, et l’amalgame est soigneusement entretenu entre soutien à Israël et défense des Juifs. Ce terrain-là est interdit. C’est un sacré non religieux mais tabou quand même.
Et c’est bien là que réside le cœur du problème : Malka ne défend pas la liberté d’expression dans son absolu, il défend une certaine idée de la liberté, celle qui s’aligne avec son propre camp idéologique. Le droit au blasphème devient alors un instrument de domination symbolique : on blasphème ce que l’on peut humilier sans grand risque, jamais ce qui est réellement sacré dans le monde contemporain : la propriété, les ultra-riches, le sionisme, la figure du pouvoir occidental.
Or, ce qui choque aujourd’hui n’est plus nécessairement religieux. Ce qui est sacré pour Malka, ce ne sont plus Moïse ni Jésus, mais des choses plus concrètes telles que le respect des femmes et des enfants, et des choses plus secrètes et discutables comme la politique israélienne. Et ces sacrés-là, Charlie ne s’en moque jamais.
Le plus inquiétant, c’est que Richard Malka continue d’occuper une place centrale dans les médias français, toujours seul, toujours sans contradiction. Jamais confronté à des historiens de la laïcité, à des philosophes du droit ou à des penseurs critiques. Il déroule son discours en roue libre, en boucle, dans des émissions où les intervieweurs sont complaisants ou acquis. Sa conversation avec Frédéric Beigbeder en est un exemple flagrant : une révérence à peine voilée, aucun rappel du passé, aucun rappel que Malka a lui-même contribué à censurer ceux qui ne pensaient pas comme lui.
Il ne s’agit pas ici de nier le droit de Malka à s’exprimer ni de justifier les violences ou les censures. Il s’agit de demander, simplement, l’application du principe même qu’il prétend défendre : le débat, la contradiction, la pluralité des voix. Qu’on l’invite, oui, mais en dialogue avec d’autres. Qu’on l’invite abondamment et qu’il reconnaisse, un jour, que le blasphème ne vaut que s’il frappe d’abord ce qui est réellement sacré pour lui.
Sinon, son « droit au blasphème » se borne à être du marketing idéologique. Une parodie de liberté qui cache un vrai rejet de l’autre. Pour parler comme les dessinateurs de Charlie, tant que Val et Malka parlent en monologue, ils ne sont qu’une caricature de courage.