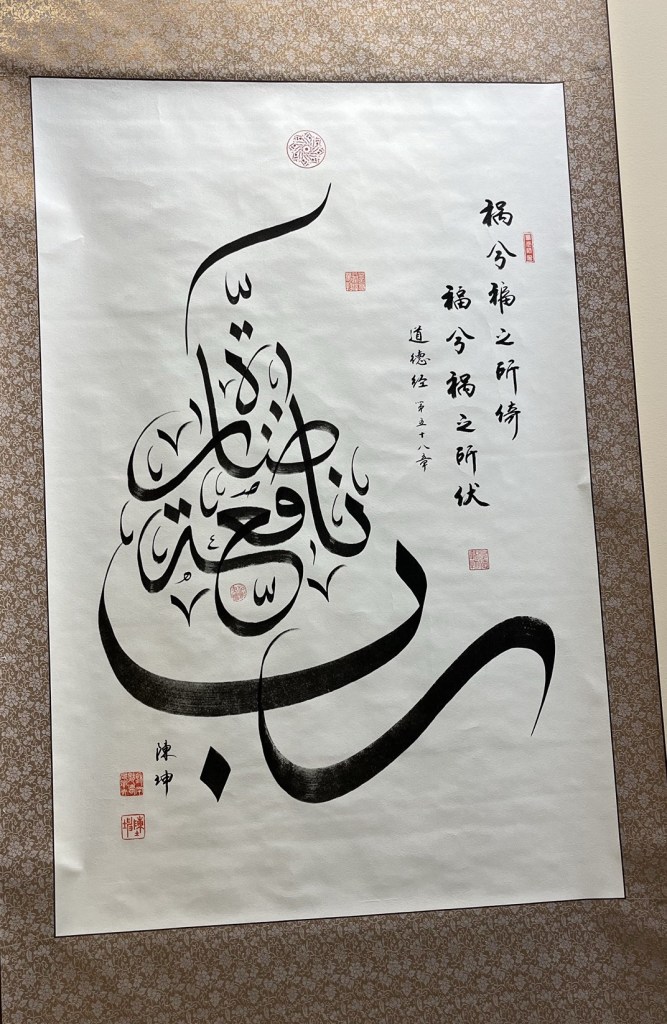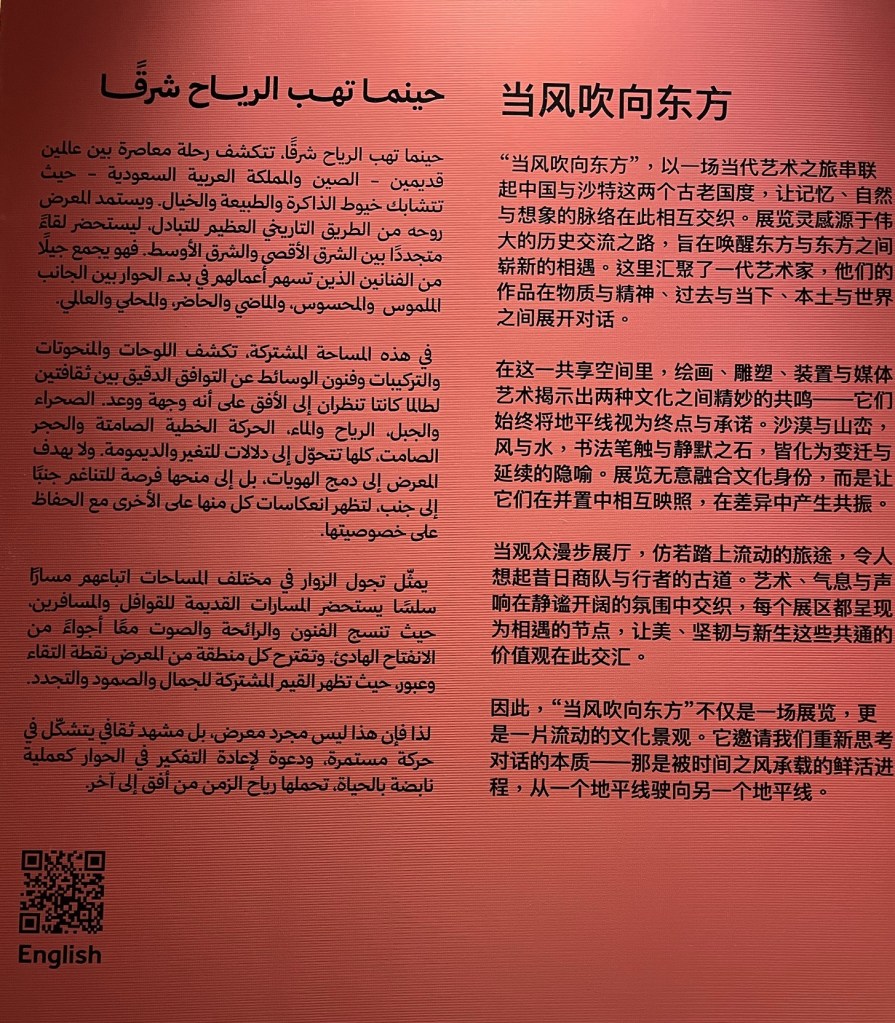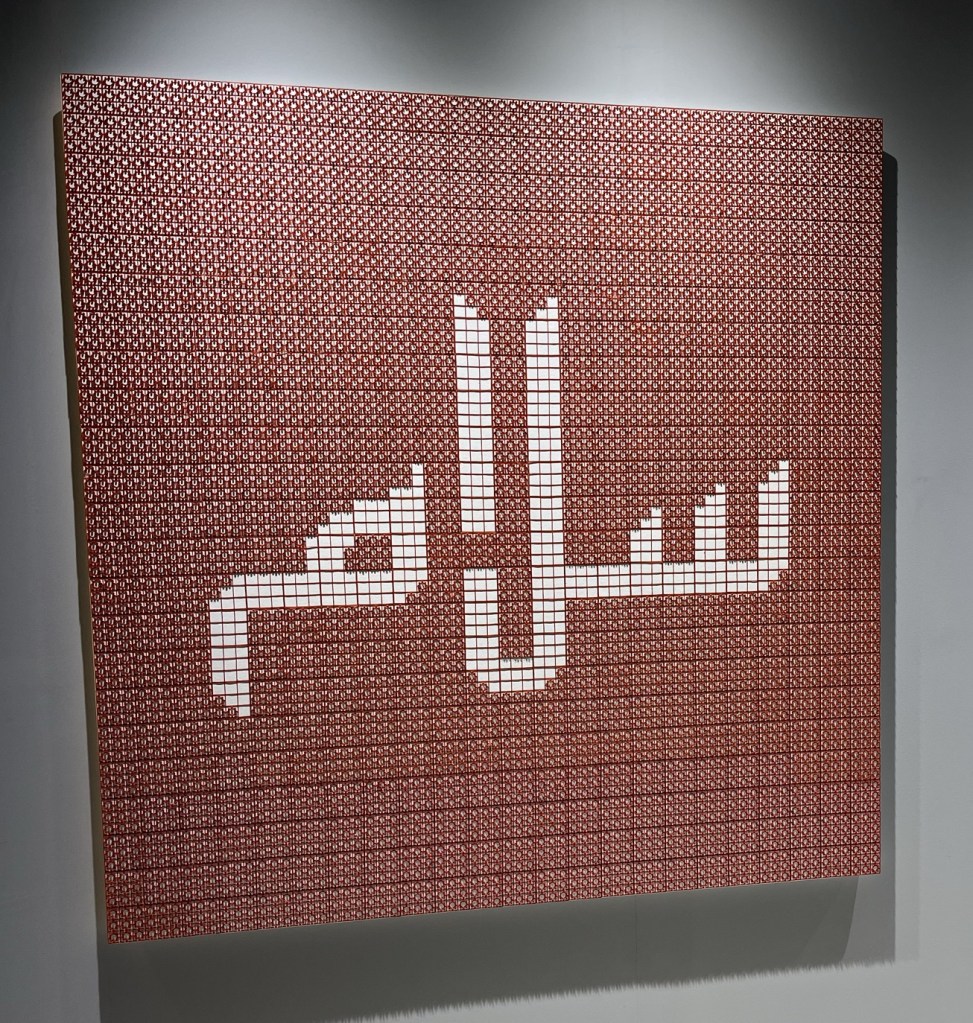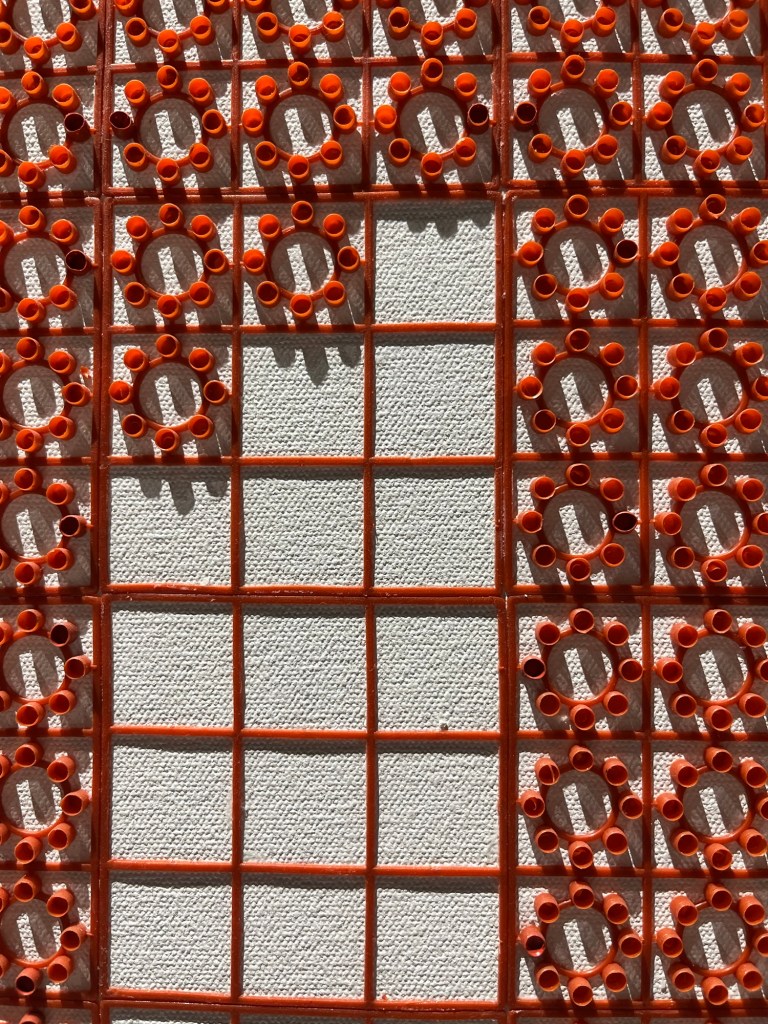Il existe en France un amour renfrogné pour la langue française. Un amour souvent présenté comme une évidence, presque comme un fait naturel. Pourtant, il m’a toujours paru un peu suspect. Et depuis que les identitaires crachent sur Jean-Luc Mélenchon qui célèbre la francophonie, la suspicion est totale : les amoureux de la langue française sont d’absurdes nationalistes.
Je me souviens déjà de ce sentiment dans les années 1980, quand Yves Duteil chantait La langue de chez nous. La chanson était célébrée comme un sommet de poésie. L’Académie française lui remettait un prix, Bernard Pivot l’invitait, et l’ensemble du dispositif culturel national validait l’idée qu’il s’agissait là d’un hommage sublime à la langue française. Mais quelque chose sonnait faux, ne serait-ce que le tout premier vers :
C’est une langue belle avec des mots superbes
Quel début de chanson merdique. Après il fera rimer « superbes » avec « fines herbes » et prétendra que notre langue sent le fromage de chèvre depuis le Mont Saint-Michel jusqu’à la Contrescarpe… Ça sent bon chez les Duteil. Voilà qui donne envie d’apprendre la langue de Molière.
Chez les agents de la télévision, en effet, on s’enthousiasmait de cette franchouillarde poésie pleine de fierté idiote devant une langue qui est aussi belle que les autres langues. Cette accumulation d’enthousiasme, cette solennité autour de la langue, avaient quelque chose d’un peu gênant.
À l’époque, la France tentait encore de se présenter comme une grande puissance culturelle, alors même que le centre de gravité du monde s’était déplacé vers les États-Unis. Cet amour proclamé de la langue ressemblait moins à une assurance tranquille qu’à une compensation. Comme si l’on se raccrochait à la langue au moment où d’autres formes de puissance échappaient.
Souvenez-vous, c’était l’époque miterrandienne où l’on parlait avec raison de l’exception culturelle. La diplomatie française militait pour que les biens culturels tels que le livre, le cinéma et la chanson, puissent être soutenus par les États sans que cela soit pris pour des coups de canif dans le dogme de la libre concurrence. Les Anglais et les Américains, pour discréditer cet effort de résistance à l’ultra-libéralisme, appelaient cela « l’exception française ». Ce sobriquet était là pour faire de nous d’arrogants défenseurs de la culture française. Nos nationalistes l’ont pris à leur compte et se sont trouvés confortables avec l’idée qu’il y avait une « exception française ».
Yves Duteil continue sa chanson avec un couplet sur le Québec, comme si notre langue n’était parlé qu’en France et en Amérique. Pas un mot sur l’Afrique. Pire, il désigne la francophonie américaine comme « une bulle de France au pays de la neige », ce qui ne peut qu’énerver nos partenaires québécois qui tendent au contraire à prendre des distances avec la France. Eux sont les premiers à affirmer que cette langue leur appartient. Mélenchon prend le contrepied de Duteil dans son éloge de la « langue commune » et a probablement raison de travailler la matière linguistique dans son programme politique en s’éloignant de tout francocentrisme. Cette langue est à tous ceux qui s’en emparent et n’est en rien une bulle de France. Elle ne sent pas plus le fromage de chèvre que la mloukhia et le rougail morue.
Il n’y a pas plus de belle langue que de beurre en broche.
J’ai retrouvé ce même cliché plus tard, en Chine, chez mes étudiants des universités de Nankin puis de Shanghai. Beaucoup disaient avoir choisi le français parce que c’était « la plus belle langue du monde ». En réalité, ils reprenaient presque mot pour mot ce qu’ils avaient appris à l’école, en traduction chinoise, en lisant La Dernière Leçon d’Alphonse Daudet. Ce texte a profondément marqué les lecteurs chinois. On y voit un instituteur annoncer à ses élèves qu’ils n’auront plus jamais cours en français, que désormais la langue de l’école sera l’allemand, parce que la France a été battue en 1870. L’homme finit par pleurer devant les enfants, ou retenir ses larmes, je ne m’en souviens pas.
Les Chinois se sont reconnus dans cette nouvelle. Ils y ont vu leur propre histoire : un peuple convaincu que sa langue, sa poésie, sa culture sont les plus belles du monde, mais dominé par d’autres, technologiquement et militairement plus puissants. L’idée que l’Occident possédait la technique mais pas l’âme de la Chine leur parlait directement.
Cela amène à une hypothèse inconfortable : cet amour excessif pour sa propre langue n’est peut-être pas un signe de force, mais de faiblesse. Une fierté déplacée, qui masque un sentiment de défaite. On se raccroche à la langue quand le reste ne tient plus.
J’ai évoqué cette idée à Hajer. Elle m’a simplement répondu : « C’est exactement la même chose avec nous et la langue arabe. »
Cela m’a confirmé que ce rapport passionnel à la langue n’est ni spécifiquement français, ni même exceptionnel. Il apparaît souvent chez ceux qui ont perdu autre chose, et qui transforment la langue en refuge, en symbole, parfois en mythe.
Et tandis que le parti de gauche LFI essaie de bâtir un espoir populaire dans une langue française qui peut se créoliser tout en s’enrichissant, les partis de la réaction s’arc-boutent sur une prétendue pureté de la langue, dont on ne saurait être trop fiers et que, bizarrement, « les autres pays nous envient ».