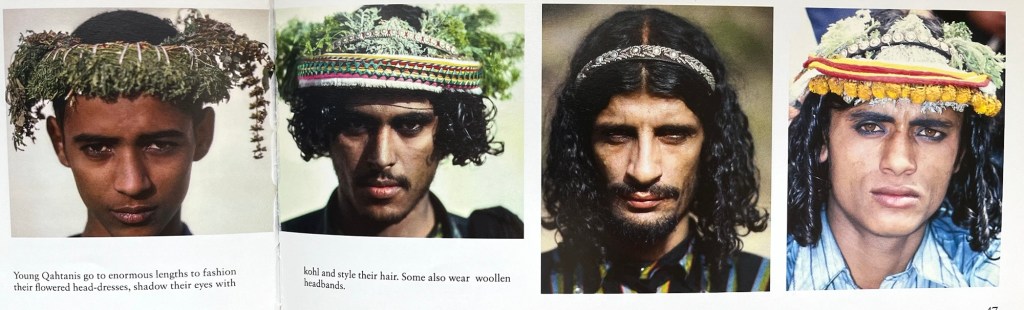Art : Cinéma
Titre original : A Perfect Unknown
Genre : Biopic
Réalisateur : James Mangold
Date de sortie : 2024
Durée : 2 heures 20
Distribution : Timothée Chalamet (Bob Dylan), Monica Barbaro (Joan Baez), Edward Norton (Pete Seeger).
Titre français : Un parfait inconnu
Lieu du visionnage : Munich, près de la rivière Isar.
Nom du cinéma : Museum Lichtspiele
Accompagnatrice : Hajer Thouroude
Date du visionnage : Mars 2025
Météo : Frais pour la saison, temps sec.
Souper post-séance : Un infâme bol de nourriture végétarienne. J’ai dû terminer les deux bols.
Note globale de la sortie : ***** (cinq étoiles)
Le film promettait de raconter un moment-clé de la vie de Bob Dylan. De ses premiers pas à New York, jusqu’à l’onde de choc provoquée par son passage à la guitare électrique. L’entrée fracassante d’une jeune star du folk dans un genre musical honni (le rock), avec, en point d’orgue, la chanson Like a Rolling Stone. L’album qui incarne ce tournant du folk vers le rock est bien sûr Highway 61 Revisited.
Malgré la promesse d’un sujet aussi dense, aussi puissant, le film m’a laissé sur ma faim. Plus encore : il m’a ému, oui, mais presque malgré lui. Pas à cause de ce qu’il montrait, mais à cause de ce qu’il réveillait en moi.
En voyant A Perfect Unknown, je me suis retrouvé transporté dans les années 1960, ce New York du Greenwich Village peuplé de chanteurs folk qui protestaient contre la guerre au Vietnam, contre l’ordre établi, et qui, mine de rien, fabriquaient une culture contestataire qui continuait les fils de la grande génération Beat. Et dans le même temps préfigurait la belle musique hippie.
À ce propos, différents mouvements de la « contre culture » existaient au temps de Bob Dylan. Lire sur ce sujet : Préférer les Hipsters aux Hippies
La Précarité du sage, 2014
Ce n’était pas seulement l’Amérique, c’était aussi un peu l’Europe, par les idées, les lectures, les résonances. Cette émotion était d’autant plus aiguë que je regardais le film avec mon épouse, qui a grandi dans le monde arabe dans les années 1990. Elle ne connaissait pas Joan Baez, ni Woody Guthrie, ni Pete Seeger. Il m’a fallu lui confirmer que oui, tel personnage avait bien existé dans la réalité. (Elle a surtout été impressionnée par Joan Baez qui, dans le film, est très sexy et n’a pas ce côté scout charmante qu’on connaît à la chanteuse). Dans ce décalage s’est révélée une forme de nostalgie : une émotion étrange, presque coupable, parce qu’elle faisait surgir un sentiment d’appartenance culturelle, de fascination pour ma propre culture. Une émotion familiale, identitaire, donc. Un chauvinisme à la con, disons le mot. Moi qui n’étais pas né à cette époque, mes parents ne s’étaient même pas encore rencontrés, quelle bêtise d’âme a provoqué en moi ce sentiment de fierté occidentale ?
Mais revenons au film. A Perfect Unknown échoue là où tant d’autres biopics échouent aussi : vouloir tout dire, tout montrer, cocher toutes les cases. En une heure et demie, on passe de l’arrivée à New York à la consécration, en passant par toutes les figures obligées : Joan Baez, Woody Guthrie à l’hôpital, Pete Seeger en apôtre du folk, les musiciens du studio, les premières scènes de haine du public, les slogans de trahison, et bien sûr, l’électrification. Tout y est à grands traits pour le public adolescent qui n’aime que les grands traits.
Ce genre de film devrait fonctionner comme une lecture lente. Choisir un moment, et le creuser, le faire résonner.
Par exemple, toute l’histoire de l’orgue Hammond sur Like a Rolling Stone aurait pu faire un film à elle seule. Ce musicien, guitariste de formation, qui est mis de côté à cause de la présence de meilleurs guitaristes dans le studio d’enregistrement, et qui propose timidement un son nouveau au clavier. On lui dit de laisser tomber mais il persiste. Son insistance finit par payer et le son de son orgue Hammond devient la marque de fabrique d’un tube international. Voilà du cinéma ! Alors que dans ce film, tout est survolé, tout est condensé, et la scène ne dure que quelques secondes : Dylan entend l’orgue au moment même où il enregistre la chanson, il sourit, et ce sourire vaut validation. Comme si les grandes oeuvres du rock se faisaient dans des improvisations sans travail entre copains.
Enfin il y a le problème Chalamet. On ne voit jamais Bob Dylan. On voit Chalamet jouant Dylan. Il singe l’élégance flottante d’un Dylan jeune, sans la crasse et le manque d’hygiène qui sont rapportés par les témoins de l’époque. Chalamet nettoie le personnage pour en faire un mythe mais c’est idiot car Dylan était déjà un mythe, et l’histoire documentaire avait déjà inclus les remugles et les mesquineries du réel. Donc ça ne prend pas. La preuve ? Mon épouse m’a dit : « Il chante mieux que Dylan. » Et cela, à mes yeux, suffit à prouver que le film est un échec. On ne chante pas « mieux » que Bob Dylan.