L’épicerie du village est souvent tenue ces temps-ci par une délicieuse personne née dans un village voisin. Ayant terminé ses études, elle repose un peu son âme en travaillant dans un endroit paisible, avant de se lancer dans la recherche d’emploi adaptée à sa formation.
Elle me présente son ornithologue de père, qui est d’accord pour que je l’accompagne dans des sorties d’observation, et que je fasse, le cas échéant, un documentaire radio sur les oiseaux de la région. Gérard est un instituteur à la retraite, grand, mince et moustachu. Sa fille m’en a parlé avec admiration, comme un homme d’une timidité maladive. Or, notre première rencontre se passe bien, il me parle des oiseaux de la région avec précision et didactisme. Il me donne rendez-vous un matin, à 7h30, pour aller observer au col de l’Asclier.
Gérard fait partie des rares ornithologues capables de reconnaître les oiseaux à l’oreille. Il connaît toutes les espèces dites communes. Il me parle des plus petits jusqu’aux plus grands rapaces. Nous avons la chance d’avoir des couples d’aigles royaux qui nichent dans la région. Dans les années 80, il n’y avait plus que neuf couples, dans tout le massif central ; aujourd’hui, il y en a plus de trente. L’aigle royal est le plus grand des rapaces d’Europe, il n’y a guère que la harpie féroce, en Amérique du sud, ou le condor des Andes qui le dominent dans le monde.
Entendre parler des aigles me fascine. Ils nichent dans des « aires » (c’est le nom du nid d’aigle) qui sont parfois vieux de plusieurs siècles et qui servent de maisons à des générations et de générations de rapaces. Parfois un grand corbeau vient investir une aire, mais peut se faire expulser par un aigle qui en a besoin, et qui ne confond jamais une véritable aire et un quelconque nid de corvidé. L’aigle est animal de territoire. Des kilomètres de périmètre, sur lequel il règne en souverain, imposant sa présence aux yeux des autres aigles en faisant des figures spécifiques dans le ciel.
Mon jardin suspendu fait partie de leur territoire de chasse et cela me fait frissonner de bonheur. Peut-être un de mes chatons sanguinaires s’est-il fait enlever par les serres impitoyables d’un de ces rapaces à la vue perçante ? Les aigles voient et analysent des informations à plus de dix kilomètres.
Pour être plus précis, le terrain de mon frère n’est pas exactement sur le territoire d’un couple, mais à la jonction de trois territoires, donc cela fait trois fois plus de chances pour moi de voir des aigles royaux. Alors les rapaces que je vois planer quelquefois, quand je suis nu dans ma baignoire d’eau de source, sont-ce des buses, des faucons ou des aigles ? Je veux croire que ce sont des aigles royaux qui tournoient au-dessus de moi, et qui scannent de leur regard inhumain les pauvres actions du sage précaire à l’assurance oscillante.
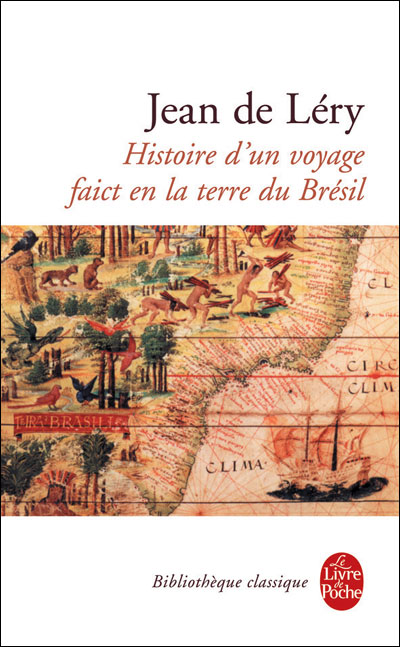
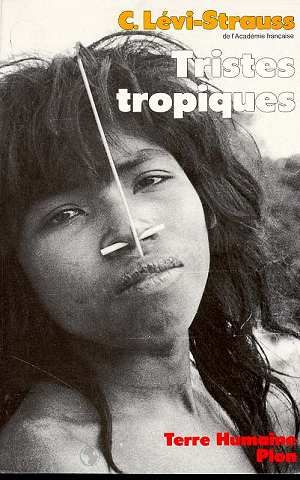

 P.Pelliot examinant les manuscrits, 1906.
P.Pelliot examinant les manuscrits, 1906.

